

Le mercredi 8 mars, le Burkina Faso célébrera, à l’instar des autres pays du monde, la cent-soixantième journée internationale de la femme. La particularité de cette commémoration au Burkina, est que cette journée, depuis le régime révolutionnaire de Thomas Sankara, est déclarée fériée par l’État. Le 8 mars est une affaire d’État au Faso, et c’est en l’honneur de ce pays où les femmes constituent plus de 52°/° de la population. Placée cette année sous le thème "La valeur morale de la personne humaine : responsabilité des communautés dans la lutte contre l’exclusion sociale des femmes", la fête des femmes mobilisera, comme de coutume et dans toutes les provinces du pays, le rouage de l’administration d’État, l’élite politique qui connaît parfaitement bien l’incidence de l’électorat féminin dans les urnes, les associations et groupement de femmes. La fête sera sans doute très belle, nonobstant la conjoncture économique ambiante. Les djamdjoba (danses populaires des femmes) magnifieront les rues de toutes les villes du pays, sous le regard contempteur de Tengsoba des partis politiques et de l’État( Tengsoba signifie chef de terre en langue nationale moré), bien pressés que finissent ces heures symboliques, pour que le cours normal de la vie reprenne, et que le masculin récupère ses droits. Il en est ainsi depuis plus de trente ans. Alors, au-delà des pas de danse, des manifestations festives, au-delà du périodique pagne du 8 mars, par tous arboré ce jour-là, au-delà des discours, où en sommes-nous, concrètement, avec la promotion de la femme au Faso ?
La question, ainsi posée, est très suspecte. Elle est suspecte, parce que bien de gens seraient tentées de lui donner comme réponse : « rien ». Ce « rien » serait pourtant un injuste petit mot péremptoire, produit par l’humeur d’une personne qui ignore que les changements sociaux ne peuvent s’opérer que dans la durée. En réalité, beaucoup de choses ont été faites au Faso pour la promotion des femmes. En la matière, et eut égard à nos lois sociaux, le Burkina est un pays de gauche, qui a une législation progressiste. Seulement, d’un côté, il y a nos lois, nos idées modernes, très favorables à la femme ; et de l’autre, il y a notre inconscient collectif, nos coutumes et nos pratiques qui, elles, sont peu féministes.
Bien naturellement, il existe des questions sur lesquelles le consensus est facile à obtenir, entre traditionalistes et progressistes. Il s’agit notamment des questions de respect de la dignité humaine en la femme. En effet, qui que l’on soit, quelque soit aussi nos valeurs de référence, on doit pouvoir reconnaître que la femme, quelque soit son âge, sa condition de vie, sa position sociale, doit être respectée comme être humain et qu’elle ne doit point faire l’objet d’exclusion. Ce sont des questions qui n’ont d’ailleurs pas besoins d’agitations féministes pour être résolues. En effet, elles sont du ressort classique des départements ministériels en charge de l’action sociale, de la solidarité nationale, des droits humains et de la justice. Ce sont des questions pour la résolution desquelles, beaucoup d’efforts ont été consentis. Malgré les pesanteurs socioculturelles, elles se résoudront, totalement, avec la modernisation progressive des communautés de base.

La lutte la plus féroce des femmes est ailleurs. Elle est à mener contre notre inconscient collectif. En chacun de nous, se camoufle une sorte de voix, venue du tréfonds des siècles, qui dit toujours : « la Femme, c’est la femme ». Voilà, là, la petite phrase chargée de toutes les connotations négatives, qu’il faut gommer de nos consciences. Cette femme-là, cette femme de notre inconscient collectif, quand elle est complètement démunie et isolée, elle passe pour la sorcière du village. Mais, quand elle réussit aussi, au point de dépasser les hommes en affaires, en politique ou sur d’autres terrains, c’est encore elle la sorcière, l’intrigante, la prétentieuse ; et c’est bien souvent d’autres femmes qui nourrissent ces ragots contre leur consœur. L’action de conversion de nos esprits ne peut donc se faire, ni par la danse, ni par les discours, ni par des lois, mais par l’éducation. En déplaçant le débat sur le terrain de l’institution éducative, le débat devient sain, transparent, républicain. On échappe ainsi à la confrontation servile entre traditionalistes et modernistes, entre féministes et antiféministes, tout en menant le bon combat. Les parités hommes-femmes réclamées, les lois sur les quotas votées par le législateur, les journées fériées, les thèmes à méditer, n’ont d’efficience que si l’école peut permettre aux femmes d’accéder, massivement, aux mêmes niveaux d’instruction et d’aptitude que les hommes. En fait, le vrai combat de l’émancipation des femmes, ce sont ces milliers de filles, dans les écoles primaires, les centres de formation, les collèges, les lycées, les facultés et les écoles professionnelles, qui sont en train de le mener. Ce sont ces filles, qu’on ne verra pas danser le 8 mars, qui sont pourtant entrain de lutter, contre les complexes et toutes les sortes d’adversités, pour montrer, aux hommes de leur génération, « que la Femme, ce n’est pas que la femme » ; « que la Femme, c’est aussi l’Homme ; que la Femme, c’est aussi le génie humain ». Sur ce terrain-là, on peut être rassuré : dans les villes comme dans les campagnes, la jeune fille burkinabé est en train de monter en puissance. Mais, pour de multiples raisons, l’éducation d’une fille est deux fois plus complexe que celle d’un garçon, et son cursus est beaucoup plus exposé à l’échec que celui de son frère. Point n’est donc besoin de dire qu’il faut que, toutes les initiatives, privées et publiques, priorisent l’éducation, l’instruction et la formation de la jeune fille, si l’on veut une émancipation durable de la femme burkinabé.
Joyeuse fête à toutes les femmes du Faso.
Zassi Goro
Zassi Goro ; Professeur de Lettres et philosophie, écrivain.
Kaceto.net





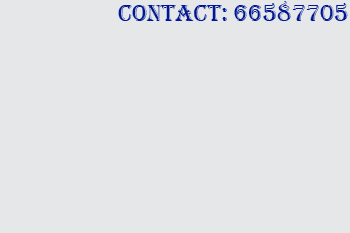






Recent Comments
Un message, un commentaire ?