

Nous entendons ici par tempérament burkinabé le profil psychologique que les conditions du milieu naturel ou socio-culturel ont inculqué en nous, sous la forme d’un inconscient collectif qui détermine notre attitude face au monde. Le Burkinabé ne nait pas avec un tempérament ; il l’acquiert au contact de la société. C’est donc d’une donnée historique dont nous parlons et non d’une réalité qui serait innée en nous.On ne nait pas burkinabé ; on le devient. C’est le résultat de ce devenir, certainement et étroitement lié au modèle d’éducation reçu de la société ou de l’école formelle, qui fait l’objet de notre regard critique.
La notion de rêve est, elle aussi, ambiguë. Le rêve, dont nous parlons ici, correspond à la projection que toute conscience fait d’elle-même dans l’espace et le temps. Le rêve c’est la projection de soi, l’imagination que l’on produit comme une sorte de plan et d’idéal de vie. Le rêve, c’est la perspective, la possibilité du changement positif. Son rôle est généralement de pousser à l’initiative, à l’innovation, à l’invention et à l’action transformatrice du monde. L’humanité n’a pu faire des progrès que parce qu’elle a rêvé, à chaque étape de son histoire, de choses nouvelles. La découverte et la conquête de nouvelles terres de vie, l’acquisition des connaissances scientifiques, les inventions techniques, les créations artistiques, les projets de société, de bonheur individuel ou collectif, tout cela a été le fruit des rêves de l’homme. Alors, le burkinabé est-il sur le chemin du rêve ?
Vous me direz d’ailleurs que c’est mieux de ne point rêver, pour éviter de nous nourrir d’illusions ; que c’est mieux d’être réaliste ; que c’est mieux de nous cramponner à ce que nous avons, plutôt que de vivre de projets fictifs. Vous voyez alors, dans ces mots il y a tout le mal burkinabé. Nous sommes courageux ; nous sommes laborieux. Mais nous manquons de créativité et d’audace. Nous sommes réalistes au point d’être résignés. Nous colportons, depuis des siècles, le stoïcisme de cette économie de subsistance, dont le souci n’est pas de transformer le monde, mais de le subir. Quand nous regardons notre histoire, on voit quelques manifestations de rêve. La première est perceptible dans le modèle dominant des sociétés traditionnelles ; elle consistait à dire : il faut réussir sa vie et être à la hauteur de ce que les pères furent ; ici, le rêve du présent est de ressembler au passé. Il laisse donc peu de place à l’innovation. Il y eut ensuite le grand rêve d’aller prospérer au Ghana ou en Cote-d’Ivoire ; ce rêve a été généré par les migrations vers les terres plus humides ; forcé au départ par le colon et devenu volontaire avec le temps, ce rêve s’est progressivement épuisé, pour finalement prendre un coup sérieux avec la crise ivoirienne. Le troisième rêve est celui que l’école du blanc a encré dans nos têtes : réussir sa vie en devenant commis du Blanc et comme le Blanc. Il y a enfin le grand rêve national de la révolution d’août, qui a donné, à tout un peuple, un bel espoir, avant de s’essouffler dans ses propres contradictions et l’action de tous ceux qui avaient intérêt à que cette jeune nation, terre de chasse par prédilection coloniale, ne fasse pas de rêve.
Aujourd’hui, nos pas s’adaptent si bien aux sentiers déjà bâtis, que notre idéal de vie, à tous, n’est que cette petite sécurité et ce petit confort du fonctionnaire d’État. En fait, c’est le petit rêve de l’africain colonisé qui a pris le dessus sur tout le reste. Ce rêveur-là, est le produit de la Sorbonne ou d’une école locale, apprécié par le Blanc, diplômé sur le banc et bienheureux dans un bureau, qui pourrait dégoter un projet juteux, un cabinet de ministre, une direction de société d’État, un mandat de député mouta-mouta. Toutes les autres belles choses qui font l’économie et le progrès d’un pays, ne nous apparaissent donc plus que comme des voies d’aventure à issue incertaine. La société et l’éducation burkinabé sont ainsi en manque de modèles producteurs crédibles et accessibles au grand nombre, qui pourraient nourrir les rêves de la jeunesse. A partir de là, tout s’effondre et nous nous surprenons à dire aux jeunes de faire preuve de la légendaire modestie burkinabé. Nous le répétons, quasiment chaque jour, comme s’il s’agissait d’une vertu à tout point de vue. Nous sommes toujours fiers de dire que le Burkinabé est modeste. Ce que nous oublions, c’est que la modestie n’est une vertu, que lorsqu’il s’agit de l’être et du savoir-être. En dehors de cela, nous devons comprendre qu’il n’y a rien de plus négatif que d’être modeste dans nos entreprises, nos initiatives et nos objectifs à atteindre. Il nous faut, tout en étant humbles dans notre mode de vie, apprendre à viser grand, à regarder haut, à penser loin et à agir en géant. Contemplons l’histoire de l’humanité ; tout ce qui y a été accompli, depuis la première pierre taillée, jusqu’au premier pas de l’homme sur la lune, a été le fruit de l’imagination d’humains, qui ont oser, qui ont rêver, qui ont été audacieux. Ne rejetons surtout pas notre insuffisance sur l’État et le politique. Chacun d’entre nous est porteur de cette tare qui nous vient de l’éducation stoïcienne reçue de nos traditions ancestrales. Nous devons changer notre modèle de l’homme, notre mode de pensée, notre façons d’aborder le village planétaire. Nous devons changer notre rapport au mode et à la vie. Nous devons apprendre à accepter que la vie est la possibilité de l’accomplissement de nos rêves. C’est juste ce qu’il nous faut pour pouvoir avancer un peu plus, parce que nous sommes déjà debout ; nous sommes déjà en marche. Il nous faut juste croire maintenant au rêve national d’un Burkina prospère et de Burkinabé rayonnant partout dans le mode. C’est notre survie dans l’histoire, en tant que peuple, qui en dépend.





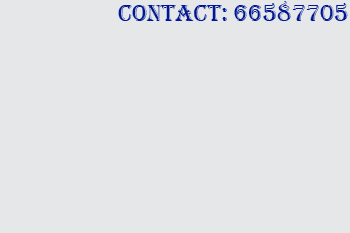






Recent Comments
Un message, un commentaire ?