

Il s’agit ici d’opérer une élucidation conceptuelle, ne dire rien de plus que ce qui devrait être connu et reconnu, mais qu’il est sans doute utile de ne pas présupposer connu, puisque cette présupposition se révèle fallacieuse à entendre ce qu’on dit et à lire ce qu’on écrit. La nécessité de l’intervention dans le débat public enjoint une telle clarification. Le diplômé est-il un intellectuel ?
Poser une telle question c’est bien entendu envisager une réponse négative ou bien se taire. En effet, la réponse positive, celle qui veut que le diplômé soit un intellectuel, réponse communément admise, ne va pas de soi. L’ambiguïté polysémique du terme l’autorise. Cette ambiguïté est déjà présente au moment même de l’institution, de la popularisation du concept qui date de l’affaire dite Dreyfus. Pour défendre l’innocence du capitaine Dreyfus, des centaines d’écrivains, d’artistes, d’universitaires font publier un texte, le 14 janvier 1898, que le directeur du journal l’Aurore titre : Manifeste des intellectuels, consacrant ainsi la substantivation de l’adjectif intellectuel pour appréhender un ensemble d’individus qui n’est pas aisément définissable sociologiquement. C’est de ce manifeste que découle l’ambiguïté, car le concept d’intellectuel, qui représente ici plus un mouvement qu’un état, une émergence missionnaire, désigne tout homme cultivé, tout diplômé ou bien la phalange aiguë des hommes qui pensent bien. Quelle est la frontière au-delà de laquelle on est intellectuel et en deçà de laquelle on ne l’est plus ?
L’intellectuel se définit par ce qu’il n’est pas. En effet, lorsque la confédération des travailleurs intellectuels, créée en 1920, donna la définition suivante de l’intellectuel « celui qui tire ses moyens d’existence d’un travail dans lequel l’effort de l’esprit avec ce qu’il comporte d’initiative et de personnalité prédomine habituellement sur l’effort physique », elle ne fait que le définir par opposition au manuel. Dans ce contexte, l’employé de bureau, le commissaire de police sont des intellectuels au même titre que l’écrivain, le professeur, le cinéaste.
Par ailleurs, lorsqu’on considère que l’intellectuel se définit à partir d’une profession, une activité génératrice de produits comme les livres, les tableaux, les œuvres musicales, etc., on soustrait des intellectuels l’enseignant qui ne fait que transmettre un savoir.
La difficulté est encore aggravée quand un même individu, en fonction des circonstances, est ou n’est pas intellectuel car s’il faut en croire E. Morin, « un médecin dans l’exercice de son métier ne se perçoit pas comme un intellectuel et n’est pas perçu comme tel, sinon lorsqu’il signe un manifeste ou participe à un acte politique (…), l’écrivain qui écrit un roman est écrivain, mais s’il parle de la torture en Algérie, il est intellectuel. Il pourrait parler de la torture en tant que simple citoyen, mais en fait il parle au nom d’un privilège particulier » (Morin, 1978). L’intellectuel se définirait ainsi à partir d’une triple détermination :
– Une profession culturellement valorisée
– Un rôle politico-social
– Une conscience communiquant avec l’universel
C’est à une telle acception de l’intellectuel que semble souscrire Bernard Henri Levy lorsqu’il écrit : « L’intellectuel, comme chacun sait, est plutôt un animal moderne. Il y a toujours eu des artistes. Il y a toujours eu des écrivains. Mais il n’y a pas toujours eu – et c’est toute la différence – des artistes ou écrivains sortant de leur discipline pour, sans l’ombre d’un mandat, et forts d’une autorité acquise ailleurs, trouver à la fois naturel et utile de venir mêler leur voix aux grands débats de la cité. Cette apparition donc est récente. Elle date au mieux de l’affaire Calas, au pire de l’affaire Dreyfus », (Levy, 1987). On aura sans doute compris : originairement c’est l’engagement qui fait l’intellectuel, l’engagement en tant que positionnement face aux événements marquant la vie de la cité. C’est par l’engagement que le diplômé devient un intellectuel sinon, il s’en distingue.
En dépit de la fin de la bipolarisation du monde ou à cause d’elle, l’engagement devient une nécessité. Il faut dire, pour reprendre les termes de Maurice Kamto, combien est responsable de la dérive collective celui qui en perçoit les signes et dispose des moyens intellectuels de la dire, mais s’en abstient par lâcheté ou indifférence. Dans cette Afrique que Eboussi Boulaga qualifie de « pathologie historique et sociale », une Afrique dépourvue de tout repère collectif, dépossédée d’un sens de l’histoire, une Afrique où le tâtonnement est élevé au rang de lucidité, l’intellectuel demeure une nécessité en tant que pourvoyeur d’idées, de valeurs, une nécessité dans la recherche d’une nouvelle politique d’émancipation collective.
L’intellectuel dont il est ici question, se démarque du courtisan que Rachid Mimouni qualifie de mercenaire prêt à se vendre, et responsable de la désertification galopante de la pensée.
L’instruction des faits par la raison et le procès par la conscience sont les guides de cet homme qui interpelle en permanence les décideurs au sujet des catégories universelles du Vrai, du Bien, de la Justice, de la Liberté. L’idéologue, le courtisan par contre se sert de son instruction pour justifier tout ce qui lui est demandé, pourvu que ça rapporte : argent, avantages divers.
Cette distinction du véritable intellectuel du courtisan ou chien de garde pour parler comme Sartre à la suite de Paul Nizan (faux intellectuel) commande une élucidation de la notion d’engagement. L’adhésion à un parti politique n’est pas la seule et essentielle forme de l’engagement même si elle est guidée par l’entrisme dont l’efficacité n’est pas avérée. L’engagement qui était celui de l’époque Dreyfus à travers le manifeste des intellectuels où l’on opposait la justice à l’Etat n’est pas ici obsolète. L’engagement peut et doit surtout prendre la forme d’une défense constante et acharnée d’idéaux, des valeurs universelles, des principes fondamentaux donnant un sens à la vie des hommes.
Nous vivons une époque où l’économique a submergé le politique et le culturel, et se pose comme lieu de production du sens. Il résulte d’une telle situation une perversion, une inversion du sens où le faux devient le vrai. Inversion du sens en tant que l’exclusion sociale, la paupérisation, d’un mot, le malheur des hommes semble apparaître comme la condition de l’efficacité d’un système dont on nous dit qu’il a pour finalité d’assurer le bonheur. L’homme n’apparaît pas dans un tel système comme la préoccupation essentielle et l’objectif final. Perversion du sens par ce que l’on peut qualifier de destruction anthropologique dont le résultat est la corruption, la vénalité devenue mode central d’opération d’un système.
C’est un truisme de dire que dans un tel contexte, l’engagement est une nécessité afin d’exiger le respect des principes fondamentaux donnant un sens à la vie sociétale. La généralisation, l’ancrage d’un tel engagement, nous semble-t-il, pourrait permettre, par exemple, dans nos processus démocratiques en panne où la majorité des dirigeants sont réfractaires à une véritable polyphonie dans l’espace politique, l’édification de sociétés où les alternances douces sont arbitrées par le peuple souverain, où les renouvellements politiques répondent à des exigences du corps social et où la transmission du pouvoir se fait suivant un code préétabli.
Dans le contexte actuel du Burkina, la tâche des intellectuels est essentielle dans l’édification d’un véritable Etat de droit. « Dire le vrai, telle est la seule responsabilité des intellectuels en tant qu’intellectuels. Sortis de cette voie, ils sont des citoyens, ils sont en politique et défendent leur opinion » , cette conception de l’intellectuel de Hannah Arendt indique la voie à suivre pour la reconstruction d’un Burkina nouveau sur les décombres de 27 ans de dictature dont l’hybernothérapie avait pour socle le concept de paix alors que c’est la liberté qui est plus essentielle.
J’y reviendrai prochainement.
G. Pierre Nakoulima ; Professeur de Philosophie à l’université Ouaga1 ; Professeur Joseph Ki-Zerbo





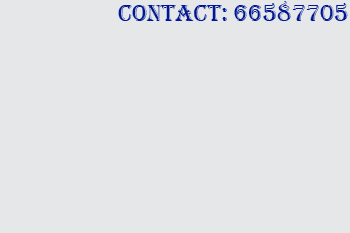






Recent Comments
1 Messages
Le diplômé et l’intellectuel, KOARA Hamidou | 13 avril 2017 - 18:44 1
Plein de sens et suscitant un sursaut dans nos vies de tous les jours.
Merci Pr
Un message, un commentaire ?