
Avec ses multiples communautés ethniques, linguistiques, l’Afrique est-elle capable d’épouser les valeurs démocratiques, c’est à dire, permettre l’expression de ces diverses identités sans remettre en cause l’unité nationale, préalable au développement économique ?
Notre chroniqueur s’interroge sur un sujet qui n’est pas nouveau et sur lequel les opinions ne convergent pas toujours.
Lorsque le 23 mai 1963, l’Organisation de l’unité Africaine apparaît sur la scène du monde et dans son berceau, à Addis-Abeba, les uns ont le sentiment que les peuples africains viennent de rater un tournant de l’histoire, alors que les autres sont convaincus que l’Afrique a fait un grand pas vers son unité. Les uns, ce sont les leaders progressistes comme Kwame Nkrumah, Sékou Touré, les partis fédéralistes, tels le Parti du Rassemblement Africain, PRA, l’aile progressiste du Rassemblement Démocratique Africain -RDA, le Parti Africain de l’Indépendance -PAI, le Mouvement de Libération Nationale -MLN, du professeur Joseph Ki-Zerbo et du philosophe Cheikh Hamidou Kane. Les autres, ce sont les partisans d’une Afrique d’Etats souverains, sans gouvernement fédéral. De toutes façons, le débat aura été pénible, parasité par les visions pan-arabistes ou pan-maghrébins de Gamal Abdel Nasser ; par les antagonismes entre pro-occidentaux, prosoviétiques et prochinois ; par les égoïsmes nationaux et régionaux ; par les conflits de leader-Ship qui opposèrent Nkrumah, Sékou Touré et Modibo Keïta à Houphouët Boigny ou à Léopold Sédar Senghor ; par les divergences de points de vue au Maghreb, entre le tunisien Habib Bourguiba, le roi Hassan II du Maroc, les leaders Ben Bella, Houari Boumédiène du FLN d’Algérie et Nasser l’égyptien. Il aura fallu alors la haute sagesse de l’Empereur Tafari Makonnen Hailé Sélassié, pour trouver ce minimum consensuel qui a permis l’adoption de la charte de L’O.U.A.
Malheureusement, ce minimum vital ne faisait l’affaire que des leaders et non des peuples et de la démocratie. La seule bonne chose sortie de ce processus, au cours duquel les congrès ont alterné avec les conférences, d’Accra à Addis- Abeba, en passant par Monrovia, Lagos, Rabat, c’est qu’il ne fallait pas remettre en cause ces mauvaises frontières tracées par le colonisateur pour balkaniser l’Afrique .
En effet, tous ont vu le risque que comportait un retour à des entités politiques précoloniales qui revenait à émietter le continent en Etats tribaux et à attribuer la souveraineté à des micro-peuples sans poids sur la scène mondiale. La crise du Biafra au Nigéria conforta d’ailleurs cette position. Le plus grand souci de tous était « l’unité ». Cette hantise de l’unité a permis d’aboutir, tout au plus, à une organisation des Etats ; mais, elle a été aussi le facteur principal de la naissance des régimes anti-démocratiques à l’intérieur des pays. En effet, d’Addis- Abeba, chacun des leaders politiques est reparti dans son pays, avec la hantise de l’unité. Non plus l’unité des Etats africains, mais celle des peuples d’un même pays, l’unité nationale.
A juste raison, pour que ces Etats, aux frontières arbitrairement tracées, puissent perdurer dans le temps sans être éclaboussés, il était indispensable de réduire les divergences entre forces politiques, comme le pensait Senghor en ces termes : « Si nous voulons bâtir une Afrique unie, nous devons le faire solidement et, pour cela, la fonder sur nos convergences culturelles, non sur nos divergences politiques, car ce qui nous lie est au-delà de l’histoire, il tient à la géographie, à l’ethnie, et partant à la culture ; il est antérieur au christianisme, à l’islam, il est antérieur à toute colonisation » . Mais, dans un contexte mondial marqué par la guerre idéologique, l’espoir d’une élimination des contradictions politiques, même pour l’intérêt national, relevait de la pure illusion. Néanmoins, les leaders les plus charismatiques, à l’image de Julius Nyerere en Tanzanie ou de Jomo Kenyatta au Kenya, réussiront à bâtir, au nom de l’authenticité africaine et le regard tourné vers les démocraties dites populaires des pays communistes, des partis uniques de gauche ou de droite, sur les cendres des opposants décimés, comme au Zaïre de Mobutu Joseph-Désiré Sese Seko Kuku Ngbendu wa Za Banga, ou comme dans l’Oubangui-Charrie de l’empereur Jean-Bedel Bokassa 1er ; tout cela sur un socle d’idées pour le moins rocambolesques. Beaucoup de ces timoniers politiques soutiendront, pendant des décennies de pouvoir, des thèses du genre : l’Afrique ignore la divergence d’opinion et la lutte des classes ; en Afrique, on parle d’une même voix, celle du chef ; un monstre ne peut avoir deux têtes ; sans unité absolue autour d’un même leader et d’une même ligne politique, le développement est impossible ; la démocratie libérale peut réveiller en Afrique les conflits tribaux ; etc… De tels points de vue conduiront fatalement au rejet de la diversité des l’opinions politiques et de l’alternance démocratique. Sous le regard impuissant de l’OUA, qui a fait inscrire dans sa charte le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, ces héros de l’indépendance africaine se transformeront ainsi en de véritables autocrates d’obédience machiavélique. Les plus faibles et les plus dérangeants pour les puissances coloniales se verront chassés du pouvoir par des militaires d’inspirations marxiste-léniniste, maoïste ou gaulliste, qui, poussés, tantôt par les forces politiques de la gauche révolutionnaire africaine, tantôt par les stratèges de la « Françafrique » néocolonialistes, finiront par créer, eux aussi, des partis uniques ou quasi-uniques. Quelques rares pays comme le Nigéria de Shéhu Shagari, la Haute-Volta du président Maurice Yaméogo et du Général Aboubacar Sangoulé Lamizana, osèrent faire des essais d’élections dites libres et démocratiques ; mais ces pays furent aussi ceux qui connurent le plus grands nombre de coups d’Etat militaires, faisant dire aux gaullistes de France que l’Afrique n’était pas mure pour la démocratie libérale.

Au bilan transitoire de la réflexion, on peut dire qu’en 1960, il n’y avait qu’une façon d’éviter le naufrage de la démocratie en Afrique ; elle consistait à aller, tout en gardant les frontières tracées par le colonisateur, vers une fédération des peuples, dotée d’institutions législatives, judiciaires et exécutives supranationales. Mais le contexte s’y prêtait mal. Les héros de l’indépendance ont mené le débat avec les regards tournés vers l’Europe de l’Ouest ou de l’Est, vers l’Amérique latine, vers la Chine de Mao Zedong, vers tout autre contrée du monde, sauf vers l’Amérique de Georges Washington et de John Fitzgerald Kennedy, alors perçue, par eux, comme le berceau de l’impérialisme mondial. Pourtant, c’est le modèle de la naissance historique des Etats Unis d’Amérique qui offrait le meilleur schéma pouvant inspirer les africains, s’ils voulaient bâtir une Afrique fédérale et démocratique. Ce n’est d’ailleurs pas par hasard que ce soit les intellectuels de la diaspora négro-américaine qui lancèrent le crédo de l’unité africaine. En tout cas, ce schéma, appliqué en Afrique, aurait permis un dépassement des rivalités interpersonnelles, des contradictions tribales, religieuses et culturelles, comme le professeur Joseph Ki-Zerbo l’a perçu, et, en même temps, une banalisation des frontières héritées du colonisateur. Une Afrique fédérée aurait obligé les forces politiques à constituer de grands partis capables d’animer le débat à l’échelle du continent, à travers des institutions fédérales fortes et aux de-là des égoïsmes nationaux qui ne reposaient sur rien d’autre que la fierté et l’intérêt des leaders. C’est ce que voulait sans doute dire Patrice Lumumba, lorsque, le 22 mars 1959 à Ibadan au Nigeria, il déclarait : « Pour moi, il n’y a qu’une voie. Cette voie, c’est le rassemblement de tous les Africains au sein des mouvements populaires ou des partis unifiés. Toutes les tendances peuvent coexister au sein de ces partis de regroupement national et chacun aura son mot à dire tant dans la discussion des problèmes qui se posent au pays qu’à la direction des affaires publiques. Une véritable démocratie fonctionnera à l’intérieur de ces partis et chacun aura la satisfaction d’exprimer librement ses opinions ». Pourtant, pour une raison ou pour une autre, en 1963, à Addis-Abeba, les héros des indépendances africaines se sont résignés à faire le choix d’une Afrique des hommes forts, plutôt que d’une Afrique des institutions fortes. La conséquence de ce choix a été que, du départ, en 1958, à l’arrivée, au grand vent du printemps arabe qui emporta le guide libyen Mohamad Kadhafi, plus d’une quarantaine d’hommes politiques, militaires, anciens maquisards ou civils, auront réussi, tel Omar Bongo Ondimba au Gabon, Paul Biya au Cameroun, Robert Mugabe au Zimbabwe, Hosni Moubarak en Egypte, à s’user au pouvoir, sur l’échine des masses populaires, alors même qu’ils pouvaient tous siéger , chacun en son temps, au sein d’un honorable congrès parlementaire des peuples d’Afrique. Mais, on ne refait pas l’histoire ; ce qui est arrivé est inexorablement arrivé. Fort heureusement, cinquante ans après l’acquisition des souverainetés, le cours du temps ramène aux africains de la nouvelle génération, l’exigence de gouvernance démocratique, avec toutes les difficultés que cela entraîne, en termes de résurgence des vieilles perceptions antidémocratiques, hostiles au suffrage universel et à l’égalité des droits. Il faut tout simplement espérer que « les échecs et les succès » du passé « ont fortifié », comme le proclame l’hymne national de la Patrie de Thomas Sankara, les peuples africains contre ces difficultés que génère l’effort de construction de démocraties de type contemporain.
Hommage à tous ceux qui, sans avoir forcément atteint leur objectif comme l’immortel Nelson Mandela, se sont battus pour la liberté et la démocratie en Afrique. Excellent séjour à tous les citoyens d’Afrique et du monde, présents au Burkina Faso pour le Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO).
Zassi Goro
Professeur de Lettres et de philosophie
Kaceto.net





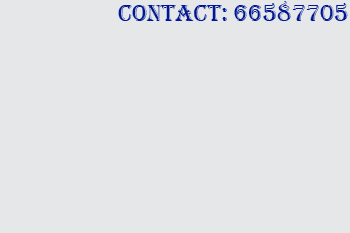






Recent Comments
1 Messages
L’Afrique : de la hantise de l’unité au naufrage de la démocratie, Nestor | 29 octobre 2018 - 22:17 1
Belle analyse du professeur. D’un parcours historique à une exposition de la recherche actuelle de la valeur démocratie sur le continent africain, le professeur nous trace la réalité. Osons croire que cette démocratie sera l’aspiration première de nos dirigeants et suivie d’un développement réel du continent africain.
Un message, un commentaire ?