
Dans l’extrait ci-contre de la communication prononcée à l’occasion des Rencontres internationales de Bouaké tenues en 1962 sur le thème, "Traditions et modernisme en Afrique noire", Amadou Hampâté Ba montre que l’organisation sociale africaine repose sur des normes socialement acceptées ou imposées qui jouent le même rôle que les lois codifiées dans l’administration moderne. Le philosophe allemand Emmanuel Kant ne dit pas autre chose lorsqu’il considère que si tout le monde accomplissait son devoir, la notion de droit n’aurait aucun sens.
Y avait-il des lois sociales africaines valables et actuellement utilisables ? Ma réponse est affirmative. Je citerai, entre tant d’autres régions, la boucle du Niger autour du lac Debo. Ce pays était celui où, avant l’occupation européenne, chacun savait où commençaient ses droits et où ils finissaient : nul n’irait, par exemple, faire paître dans une prairie privée, ou couper du bois dans des forêts déclarées sacrées, ou pêcher dans les poches d’eau déclarées demeures des génies, alors que c’était des lieux de reproduction poissonnière. Le transhumant savait quand se déplacer, par où passer et combien de temps il devait séjourner dans tel campement. L’agriculteur savait quand sarcler et quand récolter, il savait également jusqu’à quelle époque sa récolte pouvait être abandonnée en plein air dans les champs sans risque d’être mangée par le menu et le gros bétail du village. Quant au pêcheur, il n’ignorait pas quel bras du fleuve barrer et combien de temps le barrer ; les relations matrimoniales, les lois de l’offre et de la demande, la commandite, le fermage... tout était méticuleusement réglementé. En pays Dogon, c’est au Hongon, grand prêtre du culte Amma, que revenait la charge d’ordonner et d’interdire la chasse, la cueillette, etc.
Point n’était besoin de mille et un gendarmes pour faire respecter ces lois : un simple tesson de calebasse marqué de bras d’un fouet à lait, c’est-à-dire d’un signe, de croix, suffisait pour empêcher quiconque, de pénétrer dans un champ et surtout d’y cueillir un épi. Chaque homme avait sa foi pour surveiller sa conscience. Je ne vois pas en quoi une telle structure sociale serait en contradiction avec l’évolution d’un peuple. Je soutiendrai toujours que les traditions africaines contiennent des éléments hautement appréciables qui, codifiés, adaptés, sont capables de donner à l’Afrique une physionomie sociale, autonome, attrayante et conforme à la nature du pays.
Si on me demandait comment pourrait s’établir la coexistence de plusieurs types de coutumes d’âges différents, je répondrais que tout ici-bas, est affaire d’entente et de mutuelle compréhension ; chacun accorderait des concessions, ce serait plus que jamais l’occasion de mettre du vieux vin dans des outres neuves comme l’a recommandé la parabole évangélique. Je sais que le sol européen qui a nourri notre élite en ce moment au pouvoir, a secrété le lait de l’individualisme, antipode de la tendance communautaire africaine que nous avons sucée à la mamelle maternelle. Notre collectivisme est différent du marxisme par le fait qu’il part d’une cellule naturelle : la famille élargie composée de frères, cousins, etc. Une loi gouvernementale qui érigerait chaque famille élargie en coopérative de production, par exemple, en fixant les rapports des membres et leurs droits sur le gain, redonnerait à la famille africaine sa force et son affection.
Le nouveau sera que le doyen de la famille deviendra une sorte de président, responsable vis-à-vis des autorités administratives, et, la part à gagner, régie par une loi, contrairement aux dispositions traditionnelles qui laissaient au doyen le libre emploi des fonds amassés par les membres de sa famille. Chaque famille constituant une première cellule, le village constituerait un foyer au sommet. Cette procédure pourrait, à la longue, disons cinq ans, six ans ou dix ans, permettre de détecter ce que j’appellerai des sous-lois, qui régiraient les familles sans préjudice pour les lois générales que la haute autorité prendrait pour administrer le pays compte tenu des exigences politiques internationales. Ce serait une diversité, certes, mais une diversité dans l’unité nationale.
C’est par ailleurs là, un mode de vie fait de transactions très conformes à la mentalité africaine. L’Afrique n’est-elle pas le pays des calembours ? Mon père, ma mère, mes frères sont miens, mais ton père, ta mère et tes frères sont aussi miens, donc les tiens sont les miens et les miens sont les tiens. Qu’est-ce que cela veut dire ? Sinon : j’ai ma loi propre pour me régir, mais celle qui te régit peut nous gouverner.
[…]
Il faut avoir le courage de le dire : nulle part en Afrique on n’a encore une structure politique tirée des réserves traditionnelles ; tout fut calqué sur l’organisation du colonisateur. A ce jeu, on reste intellectuellement colonisé et on peut dire « l’oiseau noir n’a fait qu’occuper le nid abandonné par l’oiseau blanc ».
Après avoir suffisamment démontré comment les événements historiques — indépendants d’ailleurs du vouloir humain — sont venus de l’extérieur perturber petit à petit l’ordre intérieur de la société africaine, qu’est-ce qu’il faudrait redouter ? Qu’est-ce qu’il faudrait craindre ? — Il faut craindre que l’indépendance africaine ne se traduise par un suicide de sa personnalité, en donnant un coup de grâce aux survivances africaines rescapées de la tourmente coloniale. Il faudrait aux dirigeants à tous les échelons, une vigilance qui ne sommeille jamais, afin qu’après la suppression d’un mal qu’on peut reprocher à autrui, on ne crée point une crise dont on serait soi-même la source. C’est ici qu’il faut souhaiter que le chef de région actuel évite de tomber dans le travers de nos anciens chefs de provinces, nos commandants de cercle dans ceux de nos anciens chefs de canton et nos chefs des postes dans ceux de l’ancien chef de subdivision. Il ne faut pas que les comités politiques des cercles se conduisent à la manière des conseils d’administration d’antan. Si cela était, notre autorité n’aurait fait que changer de nom et garder le comportement tant vilipendé du colonialisme. De fait, ce serait la résurrection d’un mal abominable qu’on s’est vanté d’avoir tué et enterré profondément.
Me souvenant du problème des langues, je m’en vais en dire quelques mots.
Pour qu’un idiome devienne langue, puis langue écrite et langue de grand courant, il faut une œuvre considérable de savants de plusieurs générations. Or, il n’y a pas bien longtemps que nos hommes politiques eux-mêmes ont commencé à user des idiomes locaux — pour haranguer le peuple. Combien de linguistes avons-nous ? Combien de pays au sud du Sahara ont préconisé officiellement un enseignement même élémentaire en langues dites vernaculaires, et jusqu’à quel niveau ? Le problème exige pour sa solution de la science, du temps et de l’argent, tout cela soutenu par une autorité administrative consciente et décidée. Présentement, les rares linguistes qu’on a, sont partout sous-employés ; ils ne sont pas encore pourvus de moyens de déplacement qui les mettraient en rapport avec ceux qui possèdent à fond les idiomes. Ceux-ci, à leur tour, ne possèdent pas la formation scientifique et pédagogique pour enseigner selon les systèmes courants et universels des temps modernes. C’est l’impasse.
C’est une utopie que de croire que nos jeunes diplômés des grandes écoles européennes peuvent, à eux seuls, ressusciter leurs langues et les revivifier. Il ne les possède pas. Pour s’en convaincre, il n’y a qu’à les écouter s’exprimer en langue africaine. C’est un amalgame pittoresque, pour ne pas dire ridicule, de mots indigènes truffés de mots européens, au point qu’il serait impossible à celui qui ne possède pas les deux parlers, de saisir toute la conversation.
Nous serons loin d’être à la veille d’une autonomie culturelle tant que les gouvernements n’attacheront pas à la question l’importance nationale qu’elle mérite. En attendant, partout, les langues des anciens maîtres sont décrétées langues nationales, elles ont — il faut leur rendre cet hommage mérité — créé de grandes unités linguistiques valables à l’intérieur et à l’extérieur, tant comme facteur culturel et économique que comme instrument gouvernemental. Si je devais me pencher sur le problème des jeunes, et je le dois en tant que grand-père, père, responsable spirituel et directeur d’un Institut des Sciences humaines, je dirais que de tout temps et dans tous les pays ce problème a existé, mais à sa manière propre. [...]
Présenté par Emile Moselly Batamack
Sources : Tradition et modernisme en Afrique noire.
Rencontres internationales de Bouaké, 1962 (Collectif), Éditions du Seuil, Paris, 1965.





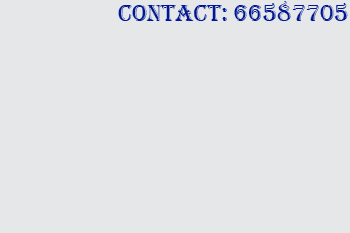






Recent Comments
Un message, un commentaire ?