
Qu’est-ce qu’être féministe aujourd’hui en Afrique ? Comment les militantes s’organisent-elles face au recul des libertés et à la montée des fondamentalismes ? Dans Féminismes africains, une histoire décoloniale (éd. Présence Africaine), la Sénégalaise Rama Salla Dieng, maîtresse de conférences à l’université d’Edimbourg (Ecosse, Royaume-Uni), fait témoigner une quinzaine de féministes influentes issues des diasporas et du continent, Maghreb inclus.
Votre essai esquisse une mosaïque de féminismes à travers l’Afrique et ses diasporas. Quels combats ont-ils en commun ?
Rama Salla Dieng La lutte contre le patriarcat est évidemment au cœur de leurs luttes, mais nombre d’interviewées s’attaquent également aux pouvoirs politiques en place accusés de perpétuer une violence politique héritée du colonialisme. Ce combat s’incarne par exemple dans la figure de Stella Nyanzi, une anthropologue et féministe ougandaise, incarcérée plusieurs mois en 2017 pour avoir publié un poème fustigeant le président Museveni au pouvoir depuis trente-cinq ans.
Cependant, cette approche décoloniale ne résume pas leur engagement. Celles que j’ai interrogées ne cherchent pas seulement à s’ériger contre ceux qui détiennent le pouvoir, mais plutôt à trouver des formes de créativité pour incarner leurs combats et réaliser leurs aspirations féministes. Elles n’en sont plus à tenter de convaincre de leur humanité. D’où l’importance qu’elles accordent à l’art, à la solidarité, à l’amour révolutionnaire et au droit au plaisir.
J’ai aussi constaté l’accent mis sur la santé mentale. C’est une notion centrale pour ces militantes. Contrairement à leurs aînées, elles politisent la question du repos, à l’image de l’Egyptienne Yara Sellam.
Des fractures existent également au sein des mouvements féministes africains. Où se situent-elles ?
Tout d’abord, il faut noter la forte dimension panafricaine des organisations féministes du continent. En 2006, une centaine de militantes réunies à Accra au Ghana a élaboré une Charte des principes féministes pour les féministes d’Afrique dans le but de faire converger leur lutte contre le patriarcat. Il existe par ailleurs des alliances transnationales qui fédèrent les différentes organisations, comme le Réseau de développement et de communication des femmes africaines (FEMNET) et le Fonds africain pour le développement de la femme (AWDF) basé au Ghana.
Mais force est de constater qu’aujourd’hui tous les courants féministes ne se situent pas au même point et, parfois, des controverses éclatent entre eux. Il y a quelques années, une féministe kényane a raillé, en ligne, les militantes d’Afrique francophone au motif qu’elles ne limiteraient leurs combats qu’à la sphère domestique et aux rapports hommes-femmes. Cela avait suscité une vive polémique.
Au Sénégal par exemple, les mouvements féministes traditionnels se battent pour la révision du Code de la famille et la reconnaissance des droits égaux entre les hommes et les femmes, conformément à la Constitution. Leur lutte se focalise aussi sur l’application de la parité et le droit à disposer de leur corps, dont l’avortement médicalisé.
En revanche, au Ghana, au Kenya et en Afrique du Sud, les féministes interviewées font de la sexualité et du droit au plaisir une question essentielle actuellement. C’est ce travail qu’ont entrepris la Ghanéenne Nana Darkoa, auteure de The Sex Lives of African Women (« les vies sexuelles des femmes africaines », non traduit) et la militante queer sud-africaine Tiffany Kagure Mugo qui a publié en 2020 un guide insolite du « bon sexe » (non traduit).
Vous évoquez un courant du féminisme africain qui essentialise la femme comme mère. Comment a-t-il émergé ?
En 1995, lorsque la Nigériane Catherine Acholonu a théorisé le « maternisme », il s’agissait de faire émerger une « alternative afrocentrique » au féminisme occidental. Dans cette pensée, le mariage apparaît comme un idéal de la conjugalité. Catherine Acholonu s’est d’ailleurs proclamée ouvertement homophobe.
Les maternistes ne militent pas pour l’égalité de genre, mais pour la complémentarité entre les hommes et les femmes dans la société. Ce féminisme réactionnaire induit l’idée que la parentalité serait uniquement l’affaire des femmes. Ce qui renforce la charge mentale qui pèse sur les mères dans le foyer et dans la société. Il est encore dominant sur le continent. Et mes travaux sur la parentalité féministe en Afrique, menés avec la professeure André O’Reilly, démontrent l’urgence de politiser cette question centrale pour transformer les sociétés africaines et instaurer la justice sociale.
Certains pays sont confrontés à la résurgence des fondamentalismes religieux, musulmans ou chrétiens, et au rétrécissement des espaces civiques. Dans le même temps émerge une nouvelle génération de féministes portée par les réseaux sociaux. Quelle est leur marge de manœuvre dans ce contexte conservateur ?
Elle est étroite, mais elle existe grâce aux réseaux sociaux qui constituent des poches de résistance. Par exemple, au Sénégal, les féministes sont en première ligne dans le combat contre Jamra, une puissante ONG religieuse qui s’en prend régulièrement aux tenues des femmes ou aux séries télévisées jugées immorales.
Dans ce contexte ultra patriarcal, ces militantes ont réussi à contourner l’un des concepts les plus prégnants de la société sénégalaise, le maslah, la « respectabilité ». Dans leurs campagnes en ligne, elles usent de termes forts et crus pour dire ce que la respectabilité empêche de dire en face. C’est un moyen de discréditer le discours fondamentaliste, chrétien ou musulman, qui tente régulièrement une offensive contre les droits des femmes et des minorités sexuelles.
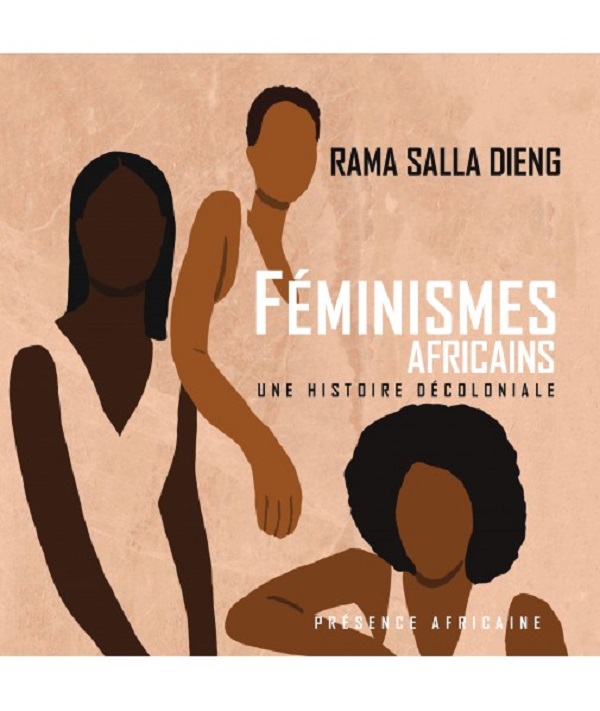
Néanmoins, ce militantisme en ligne peut-il concrètement agir sur la société ? N’est-il pas déconnecté des réalités du terrain, du fait notamment du profil de ces militantes diplômées, connectées, urbaines ?
Effectivement, l’ancienne génération de féministes reproche souvent aux plus jeunes de verser dans le « clictivisme ». Or les deux formes de militantisme – sur le terrain et en ligne – sont efficaces.
En 2020, au Nigeria, les féministes connectées ont joué un rôle majeur dans le mouvement #EndSars contre les violences policières, en mobilisant les internautes pour aller manifester. De même au Sénégal, en début d’année, les féministes ont joué un rôle crucial en diffusant le hashtag #FreeSenegal lors de la mobilisation contre le régime. Certaines d’entre elles occupent une place centrale dans la conscientisation aux questions féministes via les réseaux sociaux, à l’image de l’association féministe AWA.
Par ailleurs, militer en ligne ne protège pas des violences. A l’instar de leurs aînées, ces féministes paient le prix de leur engagement et subissent insultes et harcèlement.
Ces mouvements féministes militent aussi pour l’accession des femmes à des charges politiques. Au Sénégal, la parité est imposée à l’Assemblée nationale depuis 2010. La présence massive de femmes en politique n’a pourtant pas permis d’imposer un agenda féministe. Comment l’expliquez-vous ?
C’est l’un des paradoxes sénégalais étudié par les universitaires Aminata Diaw et Fatou Sow. Ces chercheuses ont constaté que lorsque les femmes rejoignent des partis politiques, elles sont reléguées en arrière-plan, chargées de mobiliser l’électorat féminin et d’organiser l’action politique au profit des hommes. Cet investissement sans fin couplé au sentiment d’illégitimité et au manque de moyens financiers les entravent sans aucun doute. D’autant qu’il s’agit pour beaucoup d’être reconnues comme des hommes politiques comme les autres.
Parmi les rares figures féminines africaines connues, on cite souvent des héroïnes ou des reines comme Aline Sitoe Diatta, héroïne de la résistance sénégalaise à la colonisation, ou la reine Nzinga en Angola, comme pour prouver que l’Afrique a aussi produit des femmes puissantes…
Absolument. Mais il y a urgence à écrire une historiographie féministe africaine qui s’intéresse aux « silenciées » de l’Histoire et pas seulement à l’histoire des puissants, hommes et femmes. L’histoire des résistances, des avancées africaines est aussi celle des femmes plus ordinaires. C’est ce féminisme par le bas qu’il faut révéler et raconter. Tout comme il est urgent de décloisonner les savoirs et d’apprendre des pratiques et pensées des féministes qui agissent sur le terrain.
L’Afrique a aussi eu ses féminismes et elle ne le doit pas à l’Occident. C’est ce travail de reconnaissance que mènent des universitaires hors du continent pour sortir de l’ombre des pionnières comme Suzanne Césaire, Paulette Nardal ou Andrée Blouin longtemps méconnues malgré leur apport essentiel aux luttes décoloniales.
Vous citez Françoise Moudouthe, militante camerounaise, qui estime « que l’afroféminisme porté par des femmes noires hors du continent ne fait pas assez d’efforts pour se connecter au mouvement féministe africain ». Comment expliquez-vous cette incompréhension ?
Les clivages dans les mouvements féministes sont une constante. Certains en Afrique questionnent l’usage du terme « afro » par les populations de la diaspora, comme si, du fait de leur éloignement géographique, elles ne pouvaient revendiquer un lien avec le continent.
En ce sens, l’afroféminisme peut apparaître comme déconnecté des réalités africaines. Cependant, il est à noter que les afroféministes, bien que délimitant leur espace de lutte aux pays occidentaux où elles vivent, restent bien souvent solidaires des combats portés par leurs sœurs africaines. Au final, chaque féministe parle depuis son lieu de vie, produit un discours et développe ses propres luttes.
Féminismes africains, une histoire décoloniale (éd. Présence Africaine, 2021), 219 pages, 15 euros).
Le Monde





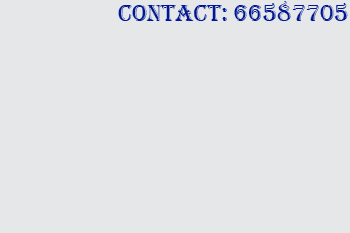






Recent Comments
Un message, un commentaire ?