
Etayé par des passages d’écrits littéraires récents, cet article de Denis Dambré montre que l’apport des émigrés à leur pays d’origine se situe davantage sur le plan des idées que sur celui des biens matériels. En conséquence, il invite les émigrés à assumer le trésor des acquis culturels de leurs années d’exil pour mieux le partager. L’auteur invite également ceux qui sont restés au pays à l’ouverture à ces apports culturels de la diaspora. Car toute l’histoire de l’humanité témoigne de la nécessité des échanges d’idées si l’on veut progresser.
Sous le titre Le parfum des fleurs la nuit (Editions Stock, 2021), l’écrivaine franco-marocaine, Leïla Slimani, a publié un livre éclairant sur le thème de l’émigration et de la bi-culturalité. A sa lecture, j’en suis arrivé à la conclusion suivante : au fond, être émigré, c’est développer les qualités d’une anguille. Autrement dit, c’est devenir un poisson à la peau visqueuse et glissante qui échappe sans peine des mains aussi fermement qu’on veuille le tenir. Car, grandissant en eau douce avant de remonter à la mer, l’anguille est connue pour sa grande capacité d’adaptation doublée d’une agilité peu commune.
L’exemple que cite Leïla Slimani concernant la « mauvaise foi » dont elle-même est capable parle beaucoup à l’émigré que je suis moi-même. Elle écrit :
« Quand on a plusieurs pays, plusieurs cultures, cela peut conduire à une certaine confusion. On est d’ici et puis d’ailleurs. On se revendique toujours étranger et on déteste en même temps que l’autre nous voie comme tel. On est de mauvaise foi. Face à un Français qui m’assure que les musulmans sont, par essence, des misogynes, des êtres violents, je défendrai bec et ongles l’ouverture d’esprit de mes concitoyens marocains, je lui fournirai mille exemples pour le contredire. A l’inverse, face à un Marocain qui essaiera de me convaincre que notre pays n’est que douceur et tolérance, je défendrai exactement l’inverse, et j’insisterai sur la misogynie et la violence qui le minent. »
Je dois avouer que, quelquefois, je ne suis pas loin de fonctionner de la même manière. Habité où que je sois par cette part invisible de moi-même que les autres ne connaissent pas bien, je peux, selon les circonstances, défendre une thèse et son contraire, non par envie de mentir, mais dans l’unique objectif de conduire mes interlocuteurs à relativiser leur vision de mon pays d’origine ou de mon pays d’adoption.
Emigrer pour moi, c’est surtout aller à la conquête d’une vision plus juste et plus objective de soi-même et du monde. C’est aussi rendre compte à ses concitoyens, d’ici ou de là-bas, du trésor déposé en soi par un parcours. L’objectif étant de contribuer ainsi à la construction d’un monde plus juste et plus équitable.
Un passage d’un autre livre – Impossible de grandir (Editions Flammarion, 2013) de la romancière franco-sénégalaise, Fatou Diome – me conforte dans ma représentation de l’émigré : « Devenir quelqu’un de la diaspora, c’est porter en soi deux êtres qui ne cessent de s’interroger mutuellement. On se demande le sens de chaque jour, de chaque acte, de chaque pas, parce que les kilomètres qui mènent à soi sont plus longs que ceux qui conduisent d’un continent à l’autre. »

Contrairement à une idée bien répandue (y compris chez les émigrés eux-mêmes), le plus important dans l’exil forcé ou volontaire ne réside pas dans les biens matériels qu’on peut acquérir (ou pas d’ailleurs !) en sortant de chez soi. L’image du Kaos-weoogo (émigré en langue mooré) qui part à la conquête de la fortune et, souvent, sacrifie sa propre vie pour sauver celle des siens, cache l’essentiel de ce que rapporte la diaspora : une juste appréhension du monde à travers l’expérience de la rencontre de l’autre.
L’émigré qui ignore cela pour ne faire valoir que ses biens matériels montre qu’il n’a pas encore pris la mesure de sa mission. De retour dans son pays d’origine, il le comprendra d’ailleurs à ses dépens. L’hypothétique fortune qu’il aura acquise pendant ses années d’exil fondra comme neige au soleil, lui laissant pour seule richesse lui-même, ce qu’il a appris dans l’expérience du déracinement, ce que le contact de l’autre et la vie ailleurs ont imprimé en lui.
Et ce savoir vaut de l’or. Il est même, à mon avis, la seule richesse qui vaille dans ce que rapporte l’émigré à son pays. Le partager est un devoir impérieux s’il ne veut s’emmurer dans un égoïsme improductif. D’autant que, comme disait le sage malien, Amadou Hampâté Bâ : « Le savoir est une fortune que l‘on peut entièrement donner sans rien perdre de ce que l’on possède ».
Cependant, force est de constater que ceux qui sont restés au pays ne sont pas toujours preneurs des idées que rapportent les émigrés. C’est un phénomène bien connu de la littérature d’exil. Ils s’empressent plutôt de raconter aux « revenants » ce qui s’est passé pendant leur absence, sans songer à les écouter sur ce qu’ils ont appris d’intéressant dans leur vie à l’étranger. Dans son roman L’ignorance, Milan Kundera établit un parallèle avec l’accueil qui est réservé à Ulysse, dans L’Odyssée d’Homère, à son retour dans son Ithaque natal :
« Convaincus que rien d’autre que son Ithaque ne l’intéressait (comment auraient-ils pu ne pas le penser puisqu’il avait parcouru l’immensité des mers pour y revenir ?), ils lui serinaient ce qui s’était passé pendant son absence, avides de répondre à toutes ses questions. Rien ne l’ennuyait plus que cela. Il n’attendait qu’une seule chose : qu’ils lui disent enfin : Raconte ! Et c’est le seul mot qu’ils ne lui dirent jamais. Pendant vingt ans il n’avait pensé qu’à son retour. Mais une fois rentré, il comprit, étonné, que sa vie, l’essence même de sa vie, son centre, son trésor, se trouvait hors d’Ithaque, dans les vingt ans de son errance. Et ce trésor, il l’avait perdu et n’aurait pu le retrouver qu’en racontant. »
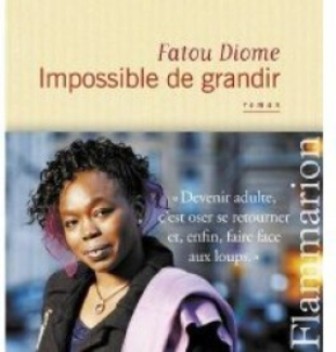
Le passé colonial de certains pays d’accueil des émigrés africains et les problèmes persistants de racisme accentuent souvent, chez ceux restés en Afrique, l’envie de rejeter par fierté ce que la diaspora peut rapporter de ces pays en termes culturels. A entendre certains discours, tout ce qui vient des pays colonisateurs serait à refuser en bloc pour se venger des drames de l’histoire. Tout, sauf évidemment les biens matériels (vieilles voitures, vieux réfrigérateurs, vieux téléviseurs…) qui sont considérés comme des symboles d’ascension sociale alors qu’ils viennent finir leur jour sur nos terres africaines peu à peu transformées en un gigantesque dépotoir du monde.
En somme, cet article vise deux objectifs essentiels. D’abord, rappeler aux émigrés que l’essentiel de ce qu’ils peuvent rapporter à leur pays d’origine réside dans les idées plutôt que dans les biens matériels. Car c’est davantage avec des idées qu’on améliore la vie d’un peuple et non avec quelques biens de consommation vite disparus. Ensuite, faire prendre conscience aussi à ceux qui sont restés au pays que, contrairement à la représentation commune que l’on a de l’émigré, l’expérience acquise à l’étranger par ces derniers présente plus d’intérêt que leurs biens matériels. En conséquence, plutôt que de rejeter en bloc les apports culturels qu’ils ramènent au risque d’assécher notre authenticité, il vaut mieux se rappeler que le dialogue des cultures est indispensable au progrès. Toute l’histoire de l’humanité en témoigne.
Denis Dambré
Proviseur de lycée (France)
Kaceto.net





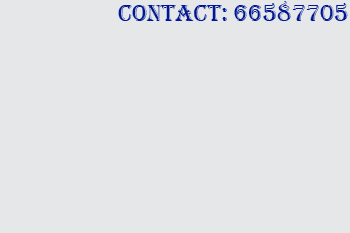






Recent Comments
Un message, un commentaire ?