
Climat, COP 27, DTS, aide publique au développement, sentiment anti-français, les nouveaux engagements de Proparco en Afrique … Ce sont les principaux sujets abordés par Christian Yoka, Directeur Afrique de l’Agence française de développement (AFD) dans sa discussion avec l’Agence Ecofin sur les enjeux de la présence de l’institution française en Afrique.
Agence Ecofin (AE) : Que représente le portefeuille de l’AFD en Afrique et quels sont les projets phares sur lesquels vous travaillez ?
Christian Yoka (CY) : Le portefeuille de l’AFD en Afrique représente à peu près 26 milliards d’euros, répartis dans les domaines des infrastructures (transport, énergie, développement urbain…), les secteurs financier, de l’agriculture, de la santé, etc.
Quant à énumérer les projets phares, nous avons du mal, car nous considérons tous nos projets comme des projets phares. Du secteur de l’éducation en RDC ou dans le Sahel, aux infrastructures en Afrique du Nord, nous avons une palette de projets sur lesquels nous travaillons. Chacun d’entre eux revêt son importance, sa spécificité et plus encore, son caractère emblématique.
AE : L’AFD est représentée à ce rendez-vous important qu’est la COP27. Quel message un pays comme la France, et un instrument important comme l’AFD, voudront faire passer lors de cette COP qui se tient en Afrique ?
CY : Merci déjà d’avoir souligné la particularité de cette COP qui se tient en Afrique. Evidemment, la France et l’AFD y sont représentés. C’est une COP qui va présenter un certain nombre d’enjeux à commencer par le sujet que porte le pays hôte, l’Egypte, qui est l’adaptation au changement climatique sur le continent.
C’est le plus grand défi auquel l’Afrique doit faire face dans les prochaines années. Malgré que l’Afrique n’émet encore que peu de gaz à effets de de serre, le changement climatique se manifeste déjà de diverses manières : l’érosion côtière, la multiplication des inondations, de la sécheresse…. C’est donc important pour l’AFD de traiter ce sujet en Afrique.
Ce sera l’occasion parfaite pour trouver des solutions urgentes afin d’anticiper les effets du changement climatique au regard de la croissance démographique, les phénomènes d’urbanisation, les besoins en infrastructures. Ce sont des éléments qui favorisent l’émission de gaz à effet de serre.
Il faut déjà intégrer ces paramètres dans les politiques, les investissements, les choix qui sont faits aujourd’hui. Par exemple, les statistiques indiquent que 80 % des bâtiments qui existeront en Afrique en 2050 ne sont pas encore construits. Or, les émissions dues aux bâtiments correspondent à 40 % des émissions de CO2 dans le monde. Si vous faites un petit calcul, vous constaterez le potentiel d’émissions que peut représenter un secteur comme celui du bâtiment. Ce sont des données qui devront être prises en compte afin qu’à l’avenir, les constructions puissent contribuer à la réduction de l’émission de gaz à effets de serre.
Il en est de même de la mobilité urbaine où la plupart des déplacements se font aujourd’hui à pied ou avec moins d’automobiles, contrairement à l’Asie. Avec la démographie grandissante, cette situation est aussi appelée à s’inverser progressivement. Ce sont donc des paramètres dont il faudra tenir compte pour l’avenir afin que le pire soit évité.
Les politiques en Afrique devront concilier deux objectifs : l’amélioration des conditions de vie des populations et la prise en charge des enjeux climatiques. Cela ne devrait pas poser de problème lorsqu’on considère les atouts dont le continent dispose : les sources d’énergies propres, le potentiel solaire, l’hydroélectricité… Il faudra aussi que les politiques publiques soient bien articulées au plan de l’aménagement du territoire, de l’urbanisation, du développement agricole et des ressources énergétiques. Ce sont bien des préoccupations qui figurent déjà dans l’agenda 2026 des priorités de l’Union africaine que nous souhaitons accompagner. Depuis l’Accord de Paris, l’AFD a mobilisé 30 milliards $ en faveur du climat dont un tiers a été consacré à l’adaptation. En 2021, nous y avons consacré 1,8 milliards de $.
Sans bien sûr chercher à déflorer les annonces qui pourraient être faites par la délégation de l’AFD lors de la COP 27, je tiens à lancer trois messages forts. Le premier consiste à insister sur l’importance de cet agenda et de la finance climat. Pour cela, nous continuons à plaider auprès des banques publiques de développement et du secteur privé pour que cette thématique soit intégrée.
Le deuxième message fort est lié à ce que je disais au départ concernant la volonté de la présidence égyptienne. C’est-à-dire, la prise en compte de la dimension adaptation de cet agenda climat.
Notre troisième message consiste à plaider pour la continuité du partenariat et des actions prévues par la COP 26 en faveur de transition énergétique juste. J’insiste sur le thème “juste” parce que la transition énergétique qui doit être accompagnée ne doit pas faire oublier les enjeux sociaux liés à toutes ces transitions. Accompagner un changement, c’est accompagner un modèle de développement qui soit plus inclusif, ce qui conduit à une transition énergétique juste.
Pour terminer, en ce qui concerne l’engagement des pays européens d’accompagner l’initiative de la transition énergétique juste en Afrique, la France s’est engagée à hauteur de 1 milliard $ au profit de l’Afrique du Sud. Nous sommes encore à la phase de la mise en œuvre de cet engagement. Avec la COP 27, nous verrons si d’autres pays ne suivront pas cette dynamique.
AE : Toutes les obédiences sont maintenant d’accord qu’il faut une transition énergétique juste en Afrique. Mais la question du contenu de cette transition énergétique continue de se poser. Avec le gaz ? avec un peu d’énergie fossile ? … puisque les pays africains sont encore à l’étape embryonnaire en matière d’installation électrique ou énergétique. A l’AFD, comment vous situez-vous sur la question ?
CY : Deux éléments sont à prendre en compte. Il s’agit d’abord de l’échéance dans laquelle on se situe. Nous traitons ici de sujets qui sont tout, sauf des projets à court terme. Ce qui est important est qu’on se mette d’accord sur les objectifs qui sont recherchés à long terme. Il n’y a pas de débat à ce niveau, les objectifs sont en tête, sauf peut-être quelques climato-sceptiques qui demeurent ça et là.
Mais l’important, c’est de se mettre d’accord sur une trajectoire qui prend en compte le mix énergétique. Aucune transition énergétique ne peut dépendre que d’une seule source d’énergie. Il faut que dans le même temps, les investissements se poursuivent en faveur du renouvelable. A l’AFD, nous sommes disposés à accompagner les trajectoires qui prennent en compte des objectifs de mixte énergétique soutenables. Il ne sert à rien de vouloir un boost économique sans s’assurer de cette trajectoire de long terme. Sinon on se projette tous dans une impasse. Ce que personne ne souhaite.
AE : A la COP 26, les pays développés ont promis 100 millions de dollars aux pays africains. Pour plusieurs acteurs basés sur le continent, le déboursement de ces 100 millions de dollars devrait être distinct des aides publiques au développement et des financements des différentes multinationales de développement. La BAD va jusqu’à dire que les pays développés devraient mettre en place un nouveau type de financement. Comment traitez-vous cette question à l’AFD ?
CY : Encore une fois, nous considérons que les banques publiques de développement devraient se mobiliser et faire du sujet climat, une priorité. Et cela a été rappelé lors du FICS [Sommet Finance en Commun, ndlr] d’Abidjan, le mois dernier. Ayant suivi les débats, vous pouvez voir les montants annoncés par les différentes banques. Pour le compte de 2021, c’est environ 307 milliards $ que ces banques ont mobilisé pour la finance verte. Il faut souvent le rappeler pour que ce soit bien entendu. C’est d’ailleurs ce qui est fait à la faveur des différents FICs. Nous arrivons progressivement à faire entendre les voix des acteurs de cette coalition que nous sommes.
AE : Comment arrive-t-on à s’engager sur ces financements ? S’agira-t-il d’un nouveau paradigme sur l’aide publique au développement qui pourra être désormais orientée vers du financement climatique ou faudra s’attendre à deux enveloppes différentes ?
CY : Non ! L’idée n’est pas d’avoir des enveloppes différentes. A l’AFD, nous essayons de faire deux choses. D’abord, depuis nos derniers plans stratégiques, nous avons décidé que nos projets devront être à 100 % alignés sur l’Accord de Paris. Par ailleurs, nous avons des objectifs de co-bénéfice climatique [financements qui soutiennent l’action climatique tout en poursuivant des objectifs de développement, ndlr] que nous avons ajoutés à nos projets. L’idée n’est donc pas d’avoir des enveloppes différentes. Il s’agit plutôt de poursuivre le financement des projets, tout en s’assurant qu’ils ont un impact significatif sur les populations. Autrement dit, nous travaillons à verdir une partie de notre portefeuille.
AE : Une autre source de financement, ce sont les DTS (Droits de tirages spéciaux). La France a pris l’engagement de consacrer 20 % de ses nouveaux droits du tirage spéciaux (DTS) aux pays africains. Lors de sa visite au Bénin, le Président Macron a réitéré cet engagement et promis même d’augmenter ce pourcentage à 30. Quel sera le cahier de charge de l’AFD dans le dispositif qui permettra d’allouer ces fonds ?
CY : Comme vous le savez, la réallocation est un sujet sur lequel nous débattons depuis 2020 quand le FMI avait annoncé les diverses allocations - 650 milliards à l’échelle mondiale et 33 milliards pour l’Afrique sub-saharienne. Selon un consensus avec les pays développés qui n’en ont pas besoin et qui ne les ont d’ailleurs pas utilisés, il était convenu que la totalité soit réallouée vers l’Afrique. Comme vous l’avez rappelé, le Président Macron était revenu là dessus. Toutefois, la question du moyen par lequel cette réallocation se fera, n’est pas encore résolue.
AE : La BAD a fait une proposition qui serait de canaliser ces DTS vers les banques publiques de développement africaines. Partagez-vous cette option ?
CY : C’est la solution qui a même été portée par la France et, bien évidemment, l’AFD défendait en effet ce schéma. Ce canal nous est plus facile à explorer. La BAD pourrait jouer un rôle d’organisme intermédiaire pour recycler ces DTS. L’objectif étant de financer le développement et encore plus dans le contexte actuel.
Les DTS sont des instruments de réserve, il faut donc des actions appropriées pour les canaliser. Il me semble que le débat n’est pas tout à fait tranché mais si l’une des options est de les faire transiter par les banques régionales de développement, nous y sommes favorables.
Mais, il appartient à chaque pays de définir la solution qui lui paraîtra la plus appropriée. Certains préféreront passer par un mécanisme de prêt pendant que d’autres voudront renforcer leur position dans le capital de ces banques. Les options sont multiples.
AE : Depuis 2020, le débat autour de la question des options techniques pour l’acheminement des DTS se poursuit et le Président Macron a été le premier à prendre des engagements. Qu’est-ce qui retarde la mise en place d’une feuille de route assez concrète pour qu’on sache s’il s’agira d’un financement additif ou d’un financement de la même catégorie que celui que des institutions comme l’AFD et d’autres banques de développement font déjà sur le terrain ?
CY : L’idée n’est pas de les mettre dans la même catégorie. A mon avis, transiter les financements par l’AFD rendrait le processus plus complexe. Pour mieux comprendre les termes du débat, il faut s’attacher à la nature des DTS : des instruments de réserve.
Une fois que leur nature est connue, la question qui se pose est de savoir quelles sont les institutions qui sont fondées à détenir ce type d’actifs et comment procéder à un acheminement efficace. C’est en réalité le sujet qui intéresse les banques publiques de développement. Et la BCE [Banque centrale européenne, ndlr] a son mot à dire.
Dès que ce sera tranché, je ne pense pas qu’une institution comme l’AFD sera nécessairement destinataires de ces ressources, sauf dans le cas de son partenariat avec la BAD qui est un potentiel destinataire.
AE : Ces derniers mois, le sentiment anti-français est monté en flèche sur le continent, surtout dans les zones d’influence de la France, sur fond de tensions géopolitiques. Paris a dû réajuster son dispositif militaire. En tant qu’institution financière axée sur le développement, cette situation affecte-t-elle votre stratégie sur le terrain ? Pensez-vous aussi à réajuster votre dispositif ?
CY : Vous avez bien fait de préciser le périmètre géographique dont il est question en mentionnant les anciens pays d’influence de la France. Pour être plus précis, je préfère qu’on parle de la situation au Sahel parce que les contextes ne sont pas les mêmes d’une sous-région à une autre.
L’AFD intervient au Sahel depuis une soixantaine d’années et, sans se donner tout le mérite, nous enregistrons des succès avérés. L’amélioration des indicateurs sociaux nous rend fiers du travail abattu au Sahel. Les différends entre la France et le Sahel n’empêchent pas que les enjeux de développement restent réels.
Toutefois, notre préoccupation première est d’ordre sécuritaire. C’est ce qui est extrêmement compliqué pour nous dans le déploiement de nos projets de développement. L’inaccessibilité d’un certain nombre de zones rend la tâche extrêmement complexe. C’est d’ailleurs ce qui nous avait conduits à nous adapter et à passer par des ONG dans un certain nombre de cas pour pouvoir continuer à mettre en œuvre nos projets. Je pense que la situation actuelle va sans doute nous conduire à réexaminer ces approches parce que pour nous, la priorité reste comment rendre nos projets bénéfiques aux populations et comment parvenir à les atteindre au mieux.
Les projets via des organisations de sociétés civiles ont vocation à être poursuivis partout où ce sera possible évidemment en tenant compte de ce contexte sécuritaire. Le sentiment anti-français, je l’avoue, est une notion que j’ai encore beaucoup de mal à caractériser ce à quoi il se rapporte.
Je me suis rendu au Burkina Faso en octobre dernier pour visiter des projets à une soixantaine de kilomètres de Ouagadougou, là où le convoi militaire avait été attaqué. Quand vous arrivez là, les populations ne se montrent pas hostiles. Pendant que je faisais la visite de nos projets de branchement d’électricité et d’eau, des gens me disaient : "C’est la première fois que nous avons de l’électricité chez nous”. Ils remerciaient ensuite l’AFD, donc la France. Sur le terrain, quand vous allez à la rencontre des bénéficiaires de nos projets, ils ne vous attendent pas avec des manchettes. Je pense donc que le concept du sentiment anti-français est à nuancer. Pour nous, en tant qu’agence de développement, ce qui est important, c’est de travailler pour le développement et d’avoir le sentiment que l’on répond à la demande et aux attentes des populations.
Au-delà de tout, c’est bien qu’il y ait des endroits où les débats peuvent être soulevés et où on peut parler de nos problèmes communs. Par exemple, parler du climat, ce n’est pas juste parler d’une préoccupation française, mais celle d’un certain nombre de pays où les impacts du changement climatique se manifestent déjà.
Quand j’étais en Tunisie, j’ai eu à discuter avec le ministère de l’agriculture qui me disait avoir des cas de migrants internes en raison de l’impact climatique. Comment réfléchir ensemble pour résoudre ce problème commun ? C’est qui s’exprime à travers la devise de l’AFD : “un monde en commun”.
AE : Quelques idées tenaces présupposées reçues sur l’aide publique au développement en disent qu’elle appauvrit l’Afrique. Quelle est votre position sur la question ? L’aide publique au développement joue-t -elle encore un rôle de premier plan ?}
CY : D’abord, le débat sur l’utilité de l’aide publique de la France est un vieux débat universitaire et il existe plusieurs points de vue. Par exemple, des penseurs comme Dambisa Moyo pensent que l’aide publique au développement est une catastrophe qu’il faut stopper. D’autres philosophes comme Jeffrey Sachs [économiste américain, ndlr] expliquent combien de fois c’est important. Quand vous lisez la littérature, vous voyez que sur ce débat, il y a des pour et des contre. Mais, en réalité - je me garde de toute comparaison - c’est comme quand vous parlez de l’existence de Dieu ; vous trouverez des arguments positifs et des arguments négatifs sur la question.
Sur le sujet, on se rend compte que l’aide publique au développement fonctionne sur la base d’un certain nombre de prérequis ou d’atouts. C’est pourquoi, quand on parle d’aide publique au développement, je considère que le mot le plus important, c’est : "aide". Une aide ne consiste pas à rendre dépendant, mais contribue à l’indépendance. Il faut la prendre pour ce qu’elle est. Par exemple, si vous construisez une maison et que vous appelez à l’aide, ce n’est pas pour qu’on vienne faire le travail à votre place, mais qu’on vous tend une main secourable afin que la tâche soit plus rapide et plus facile.
Il faut également ajouter que l’efficacité de l’aide apportée dépend des conditions qui l’accompagnent notamment, la bonne gouvernance. En ce qui nous concerne, tous nos projets sont objets d’indicateurs de performance qui nous permettent de savoir si nos objectifs ont été atteints ou non.
AE : Quels sont les impacts de vos projets et comment arrivez-vous à les mesurer sur le terrain ?}
CY : J’en profite pour vous raconter une petite anecdote. En 2018, j’étais au Kenya et j’ai assisté à une interview que le Président Kenyatta avait accordé à CNN International. Une chaîne de télévision américaine, pas une chaîne française, je souligne. En parlant de la trajectoire de développement du Kenya, il dit ceci : “Sans la France, sans l’AFD, le Kenya ne serait pas là où il est actuellement en matière énergétique”. Il faut dire qu’on a beaucoup investi dans le secteur de l’énergie au Kenya. Je pense que c’est aux bénéficiaires de juger si nos projets leur sont bénéfiques, à travers leurs divers témoignages.
De notre côté, nous nous appuyons sur nos indicateurs de performance qui sont d’excellents moyens pour jauger l’efficacité des projets ayant rapport à l’accessibilité de l’électricité, de l’eau, de l’éducation, à la scolarisation des jeunes filles… Ce sont ces indicateurs qui nous permettent de constater une stricte amélioration au Sahel au cours des 20 dernières années. Nous n’allons pas nous attribuer tout le mérite, mais le débat de l’utilité devrait porter sur des indicateurs.
AE : En Afrique, le secteur privé est un secteur qui est appelé à jouer un grand rôle dans le développement. De façon globale, quelle est la stratégie de l’AFD le concernant ? {{}}
CY : Tout d’abord, il faut rappeler que l’appui au secteur privé est l’une des priorités au sein du Groupe AFD.
Je rappelle que le portefeuille de l’AFD en Afrique est de 26 milliards $. En 2021, nous avons pris de nouveaux engagements pour un total de près de 4,9 milliards $ dont 1,2 milliards $ de la part de Proparco, notre filiale dédiée au secteur privé. C’est tout de même significatif, car cela représente 50% des interventions globales de Proparco (environ 2 milliards $).
Je précise que l’AFD intervient dans le secteur privé en particulier pour que le secteur puisse bien s’épanouir à travers l’amélioration du climat des affaires et pour y arriver il faut un personnel qualifié. C’est pourquoi nous nous intéressons davantage aux projets qui promeuvent la formation professionnelle. Cela permet à la jeunesse de trouver de l’emploi, participer et contribuer à la dynamique du secteur privé.
Notre stratégie en Afrique part de sa croissance démographique et de la jeunesse de sa population. Elle veut permettre à la jeunesse de trouver du travail ou de s’auto-employer sans forcément attendre le secteur public. Pour y arriver, il faut que des conditions soient réunies, notamment l’existence d’infrastructures (l’énergie, les routes, les bâtiments…) et un secteur financier dynamique pour pouvoir accompagner tout le tissu des PME. C’est ce à quoi s’emploie Proparco.
Notre objectif c’est de soutenir tous les projets dans tout l’écosystème entrepreneurial, surtout les start-up, incubateurs, accélérateurs, etc. Nous le faisons à travers l’initiative “Digital Africa”, une filiale de Proparco dédiée à l’amorçage des start-up “Made in Africa” dans le numérique.
AE : Cette initiative a connu des hauts et des bas. Où en est-elle actuellement ?
}
CY : Au sommet de Montpellier, le Président Macron avait annoncé qu’on doit doter “Digital Africa” de 30 millions d’euros sur les trois prochaines années, soit 10 millions d’euros sur chaque année. “Digital Africa” se trouve maintenant dans de bonnes conditions financières.
Grâce aux moyens substantiels que “Digital Africa” met à disposition pour la réalisation des projets, l’écosystème des Start-up est désormais une réalité.
AE : Proparco a cédé ses positions dans la Bicici, on apprend aussi qu’il souhaite quitter certains tours de table, notamment Oragroup. Ces retraits sont-ils les signaux d’un début de désengagement stratégique dans le secteur bancaire africain ?}
CY : Il ne s’agit aucunement d’un désengagement. Proparco est une institution de développement dont l’approche est d’accompagner un certain nombre d’acteurs en leur apportant les ressources dont ils ont besoin. Elle n’a pas vocation à rester de façon permanente au tour de la table d’une institution, surtout lorsqu’elle (l’institution) devient autonome, viable, etc.
En règle générale, Proparco investit avec des clauses de sortie qui peuvent durer 7 ans à 12 ans en fonction des investissements afin de pouvoir continuer ses actions avec d’autres institutions.
Proparco se désinvestit tellement peu que vous avez dû entendre parler de l’initiative française “Choose Africa” qui a mobilisé un financement de 3 milliards d’euros pour la promotion des PME et de l’entrepreneuriat en Afrique. Via cette initiative, Proparco a participé à la création de près d’1 million d’emplois et soutenu 26 000 entreprises en Afrique. Une raison de plus qu’il n’y a pas de désengagement sur le continent.
AE : L’AFD était initiatrice du sommet “Finance en Commun” (Finance in Common), de l’IFDC et plusieurs autres initiatives dont l’objectif est de fédérer les banques publiques de développement. Pourquoi votre institution semble se donner cette mission d’unifier les banques publiques de développement dans un contexte mondial marqué par la multipolarité ? Quel est l’objectif final ?}
CY : L’idée, ce n’est pas d’unifier les banques publiques de développement au sens de n’avoir qu’une seule entité. Il s’agit plutôt de la création d’un creuset qui puisse réunir toutes les banques publiques de développement à travers le monde pour leur permettre de s’exprimer, de poser leurs préoccupations et pourquoi pas, nouer des partenariats. C’était l’objectif de la première édition du sommet “Finance in common” de Paris qui a connu la présence des acteurs chinois, américains, européens, africains, asiatiques… Ces sommets nous permettent de débattre de préoccupations communes telles que : le climat, la sécurité alimentaire (cas du sommet de Rome), etc.
Notre objectif n’est donc pas à l’encontre du multilatéralisme. Au contraire. Grâce à ce regroupement, les banques discutent avec la Banque mondiale, le FMI. Chacun arrive à se faire entendre et à partager son expérience. Dans leurs pays respectifs, elles [les Banques publiques de développement, ndlr] sont considérées comme des acteurs extrêmement importants. Nous sommes contents de travailler avec la BOAD (Banque Ouest Africaine de Développement), la BRD (Banque Rwandaise de Développement)… Cela facilite les choses et nous permet de traiter un certain nombre de sujets ensemble, de manière à être efficace au bénéfice des populations. On parle ici d’institutions sœurs puisqu’on se considère au même pied d’égalité.
Agence ECOFIN





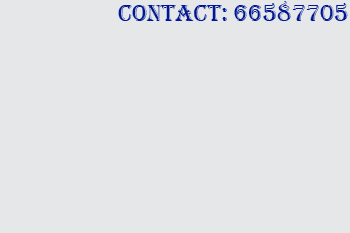






Recent Comments
Un message, un commentaire ?