
La Fondation pour la mémoire de l’esclavage (FME) et l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) ont organisé à Dakar au Sénégal, début novembre, un colloque international portant sur la question des esclavages dans le monde, dont l’objectif était d’établir précisément un état des lieux des recherches sur ces pages d’histoire tragique. Cette rencontre a réuni plus de cinquante participants venant du Sénégal, du Cameroun, du Congo, du Togo, d’Haïti, du Gabon, de Mauritanie, de France, de Guyane, de Martinique, du Danemark, des États-Unis, du Canada, de Suisse, de Grande-Bretagne et d’Italie. Le président de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, Jean-Marc Ayrault, a ouvert les travaux et il a participé à l’ensemble des conférences et des débats. Nous lui avons posé quelques questions sur la portée de cet événement scientifique et historique. Entretien.
Le Point Afrique : M. le Premier ministre, vous êtes le président de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, une fondation qui a vu le jour dans la ville de Nantes. Vous êtes présent à Dakar au Sénégal pour la tenue des assises sur l’état des lieux et de la recherche sur l’esclavage à travers le monde. Pourquoi le choix de Dakar pour une rencontre scientifique qui réunit des chercheurs venus d’Europe, des Amériques et bien entendu d’Afrique ?
Jean-Marc Ayrault : Permettez-moi tout d’abord d’apporter une précision : c’est mon itinéraire personnel sur la mémoire de l’esclavage qui a pris naissance à Nantes. Lorsque j’en étais maire, j’ai inscrit cette page de l’histoire dans la mémoire locale. La FME, elle, a son siège à Paris, à l’Hôtel de la Marine, là où l’administration des colonies a été installée pendant plus d’un siècle ; cela marque son statut d’institution nationale. Et aujourd’hui, c’est la dimension internationale de l’histoire de l’esclavage que nous voulons mettre en avant.

Pourquoi Dakar pour le faire ? Parce que l’Afrique a été partie prenante de cette histoire, mais aussi et peut-être surtout parce que nous voulions montrer qu’aujourd’hui il y a sur le continent beaucoup d’historiens et d’historiennes qui étudient cette histoire. Nombre d’entre eux travaillent ici, à Dakar, comme Ibrahima Thioub, avec qui nous collaborons depuis la préfiguration de la FME en 2017. La fondation souhaite collaborer avec eux et leurs réseaux internationaux pour faciliter les échanges.
« La recherche sur les esclavages dans le monde : un état des lieux », pourquoi avoir choisi ce thème et dans quelle perspective ?
C’est un thème et c’est un programme. Après avoir travaillé l’année dernière en partenariat avec le Comité pour l’histoire économique et financière de la France sur les liens entre esclavage et économie, aujourd’hui, nous voulons montrer la vitalité de la recherche francophone sur les esclavages. Je dis bien « les » esclavages, car durant ce colloque, il n’a pas été question que de l’esclavage colonial, mais aussi, par exemple, de l’esclavage par ascendance qui existe encore dans certaines sociétés ici en Afrique.
Ce thème est aussi un programme, car, en organisant cet événement avec l’AUF, nous avons envie d’accompagner la coopération, d’abord entre les chercheurs africains dont nous espérons qu’ils se saisiront de ce colloque pour mettre en place des réseaux et renforcer leurs partenariats internationaux. Et comme avec notre colloque à Bercy l’année dernière, en dressant cet état des lieux, nous espérons également montrer l’ampleur des questions qui restent à traiter, et donc à relancer l’intérêt pour la recherche historique sur les esclavages.
Après deux journées de colloque, je crois que nous pouvons dire que ces deux objectifs ont été atteints.
Dans le monde dans lequel nous vivons où les replis identitaires se multiplient, pouvez-vous nous dire quels sont les véritables enjeux de ce colloque sur les esclavages et quel en serait le message ?
Il y a tout d’abord un enjeu de compréhension du phénomène de l’esclavage : celui-ci est encore trop souvent perçu de façon superficielle, essentiellement à partir de la traite et des marchés d’êtres humains. Le colloque éclaire tous les rouages de la mécanique de l’esclavage, les caractéristiques des sociétés esclavagistes, de ce qu’elles font aux êtres humains, mais aussi comment les arts et la littérature, à côté du travail des historiens, contribuent à en réparer les séquelles.
Il y a ensuite, je l’ai dit, un enjeu de montrer que l’esclavage ne se limite pas à l’esclavage colonial. Que d’autres formes de travail contraint assorti de discriminations existent dans d’autres contextes, parfois encore aujourd’hui, si l’on songe à l’esclavage par ascendance dans certaines parties des sociétés africaines.
Ce constat amène à une troisième dimension également présente dans le colloque : c’est l’enjeu de la désessentialisation de l’esclavage : aujourd’hui encore, trop de personnes continuent de mettre un signe égal entre « esclave » et « Noir » ; les idéologies racistes qui sont nées des sociétés esclavagistes pour en justifier l’injustice n’ont pas disparu. Il en reste des traces dans les inconscients et il est indispensable de les extirper en montrant la complexité du phénomène de l’esclavage.

La question de la réparation a été, certes, évoquée, mais ce qui ressort de ces travaux intenses, c’est l’importance de la mémoire et l’importance du combat contre l’oubli, tant l’esclavage a changé la géographie humaine du monde ? Quel est votre sentiment à ce sujet ?
Je crois que le débat sur la manière de réparer les conséquences des injustices de l’esclavage colonial est non seulement légitime, mais qu’il est nécessaire.
Il est légitime parce que les effets de ce passé continuent à se faire sentir, et qu’ils ne sont pas sans lien avec les enjeux contemporains les plus vitaux, notamment les enjeux environnementaux. On le sait particulièrement au Sénégal, où Saint-Louis – une ville née de la colonisation il y a plus 350 ans – pourrait disparaître à cause du réchauffement climatique lié aux activités humaines des derniers siècles.
Ce débat est nécessaire parce qu’il n’y a pas qu’une manière d’envisager la réparation des blessures du passé. La réparation de quoi ? La réparation à qui ? La réparation comment ? La réparation dans quel but ? À aucune de ces questions il n’y a de réponse simple, mais toutes méritent d’être posées et discutées, dans une discussion qui doit être portée au niveau mondial, en partant des faits, en ayant établi ces faits, et en ce sens, parce qu’il a pour objectif de faire avancer la connaissance, ce colloque fait lui-même partie de cette discussion.
La question des Africains qui ont contribué au développement de l’esclavage par la vente aux Blancs d’Africains capturés dans l’arrière-pays par d’autres Africains a été un des sujets débattus, est-ce essentiel pour comprendre la nature de ce qui s’est joué durant la traite des esclaves ?
L’Afrique n’est pas un bloc politique ni culturel homogène à l’époque où les marchands venus d’Europe commencent leurs premiers échanges. La notion « d’Africain », comme celle de « Noir » est construite par ce regard extérieur et rapidement naturalisée pour faciliter la marchandisation d’êtres humains avec l’essor de la traite.
Sur ce vaste continent, comme ailleurs dans le monde, on observe aussi ce qui est à la base de l’esclavage : un rapport de domination entre une fraction de la société qui s’arroge le droit de dominer une autre partie de la société, des conflits entre pouvoirs locaux qui permettent la mise en esclavage des vaincus. Pour justifier cette domination, on l’habille de justifications, que ce soit celle du lignage dans les sociétés traditionnelles, ou l’idéologie de la race et de la supériorité de Blancs sur les Noirs quand il fallait trouver une excuse à la colonisation et à l’esclavage colonial.
C’est la raison pour laquelle les sociétés africaines doivent elles aussi regarder cette réalité en face, et je suis heureux que ce colloque ait permis de le faire, et que pour une large part ce sujet ait été défriché et discuté par des chercheurs africains.

Pourquoi est-ce important pour la Fondation de la mémoire de l’esclavage de continuer à œuvrer en France pour faire avancer les recherches sur cette tragédie humaine ?
Parce que cette page de l’histoire a fait ce que nous sommes. Elle a changé radicalement le peuplement de certains territoires qui font toujours partie de la France – je pense aux Antilles, à la Guyane, à la Réunion et à Mayotte. Elle a introduit quelque chose de l’Afrique dans la culture française dès le XVIIe siècle. Pendant plus de 200 ans, elle a directement touché 4 millions de personnes. Elle a été aussi un problème sur lequel la République a pu tester la sincérité de ses idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité. Les siècles de combat pour démanteler l’esclavage, puis pour affirmer l’égalité et accepter la décolonisation ont trempé nos valeurs, mises à l’épreuve par la perversion intrinsèque du système colonial.
Comme l’affirmait notre conseil scientifique dans sa déclaration du 30 novembre 2020, « on ne peut pas comprendre les grands phénomènes auxquels nos sociétés sont confrontées – leur diversité et leurs fractures, leur inventivité et leurs contradictions, le jeu complexe en leur sein entre le particulier et l’universel… – sans analyser leurs liens avec ce passé et les héritages qu’il nous a légués ». Et c’est encore en plein accord avec ce conseil que je réaffirme que notre démocratie a besoin de cette recherche, a besoin du débat informé qu’elle permet pour regarder en face les blessures du passé et relever les défis de notre monde qui vient.
Le Point Afrique





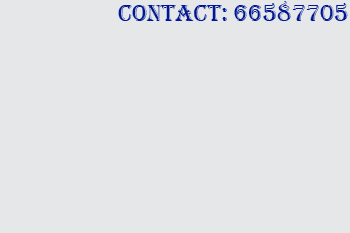






Recent Comments
Un message, un commentaire ?