
Directeur d’Universal Music Africa, filiale d’Afrique francophone de la major Universal Music Group, Franck Kacou Alcide était présent à Abidjan au Salon des Industries Musicales d’Afrique Francophone (SIMA). Celui qui était connu sous son pseudonyme de rappeur, Black Kent, se confie à l’Agence Ecofin sur l’industrie musicale africaine, les tendances de la partie francophone du continent, la digitalisation du secteur et ses perspectives.
Agence Ecofin : Quelle était l’intérêt pour Universal Music Africa d’être présent au SIMA ?
Franck-Alcide Kacou : Pour moi, ça fait plus que sens parce qu’au-delà de la partie production d’artistes et production d’évènements qui touche nos domaines d’activité, je me suis donné comme mission d’accompagner la structuration de l’industrie musicale locale. Cela passe par le fait d’adresser des problématiques comme celles liés à la digitalisation, à la transition numérique dans laquelle nous nous trouvons. Dans cette révolution numérique, le marché africain ne doit pas être mis à part et donc c’était important pour nous d’en parler ici au SIMA.
AE : La fracture numérique est encore très forte sur le continent. Est-ce que vous pensez que c’est déjà le bon moment pour parler de digitalisation et de distribution améliorée et d’autres concepts déjà en vogue en Europe ?
FAK : Je pense qu’il y a eu une transition numérique dans le reste du monde durant les années 2000 et que le continent n’a pas suivi cette dynamique globale. On se retrouve aujourd’hui avec un retard qu’on doit rattraper et la pire chose qui puisse arriver est de rester dans un statu quo et de conserver des modes de consommations qui ne sont plus pertinents. La Côte d’Ivoire, par exemple, c’est 28 millions d’habitants et 38 millions de téléphones. Alors oui, seulement 40% de la population a accès à internet, mais les chiffres montrent un véritable potentiel pour le marché musical digitalisé. Donc les signaux sont là. La fracture numérique existe mais on ne peut pas se cantonner à conserver des pratiques qui ne sont plus d’actualité aujourd’hui, il faut accompagner la transition.
AE : Est-ce l’une des raisons qui a poussé Universal Music à lancer une représentation physique en Afrique francophone ?
FAK : D’abord, la volonté de s’installer en Afrique s’inscrit dans une vision globale du groupe qui est de promouvoir la musique et les talents locaux. Avec Internet on a des frontières qui n’existent quasiment plus. Le tube « Gangnam Style » était un phénomène coréen, puis il y a eu « Despacito », latino-américain, et désormais toute la vague Afrobeats. S’il n’y avait pas de groupes internationaux sur ces territoires pour détecter ces talents et les rendre accessible au monde, je pense qu’il n’y aurait pas ce même accélérateur pour l’intérêt par exemple des jeunes Français pour la musique latino, africaine ou même de la K-pop (terme désignant plusieurs genres musicaux originaires de Corée du Sud ; ndrl) qui est actuellement un mouvement qu’on n’arrête plus. On est là pour détecter les talents, les développer en local, parce que nous croyons au potentiel du marché local. On croit aussi en la capacité des artistes locaux à influencer la musique internationale. On le voit bien en France, la plupart des artistes les plus écoutés sont issus de la diaspora et ont des sonorités afro dans leurs morceaux. Evidemment ce signal a également influencé notre volonté de nous installer en Afrique, mais la motivation première reste le développement des talents locaux.
AE : A votre arrivée, vous qui avez eu une carrière musicale en France, est-ce que vous avez remarqué de réelles différences sur le marché musical africain ?
FAK : Bien sûr. En Afrique, on est sur un marché qui est complètement hybride. Il y a des spécificités qui sont propres à nos territoires africains. Le marché est digital oui mais avec un problème d’accès à internet et un problème de valorisation des contenus qui circulent sur internet et ça c’est une particularité propre au continent. On a également un problème de connaissance de nos métiers. Le rapport qu’on a aux artistes et aux producteurs est différent aussi parce que culturellement et socialement on a des rapports qui humains qui sont différents en Afrique. Moi qui suis né ici, après être parti et revenu j’ai été confronté à ces différences. Ça a pris du temps de s’y adapter, mais aussi bien Universal Music Africa que moi sommes désormais adaptés à ces spécificités du continent africain.
AE : Vous n’êtes pas la seule major ou le seul grand groupe musical présent sur le continent. Comment se passe la concurrence avec les autres majors et la collaboration avec des groupes de streaming comme Spotify, plus présent sur le continent ?
FAK : L’Afrique est un marché ouvert et il y a d’autres majors présentes. Il y a également des pure players et fournisseurs de streaming comme Spotify et Apple Music qui se sont lancés récemment en Afrique. Il y a également des plateformes locales comme Boomplay. Nous licencions nos contenus à ces plateformes sans forcément regarder ce que les concurrents font parce que nous avons des conditions bien particulières. Le plus important pour nous est d’assurer que l’intérêt de nos artistes et leurs ayants-droits est protégé lorsque le contenu est exploité.
AE : Lors de la première journée du SIMA on a remarqué que de nombreux artistes ou producteurs ne comprenaient pas bien certains concepts liés à la digitalisation de l’industrie musicale. Est-ce que nous sommes déjà au point où les acteurs de l’industrie ne peuvent pas faire sans comprendre des concepts comme les droits voisins où les dynamiques économiques du streaming musical ?
FAK : Ce n’est pas « important », c’est « nécessaire ». Tous ces droits voisins, ces concepts légaux et administratifs sont les choses qui permettront à l’artiste de vivre de sa musique et aux producteurs d’avoir la maitrise de l’environnement légal du streaming, des institutions dans lesquelles doivent s’inscrire les artistes, des démarches à faire après l’enregistrement d’un morceau et du fonctionnement des organismes de gestion collective. Si tu ne sais pas tout ça, tu ne peux pas défendre tes droits, tu ne peux pas aspirer à vivre de ta musique correctement, parce qu’attendre les gombos du weekend après la sortie d’un single (petits revenus additionnels ; ndrl), ça ne suffit pas. Ça ne fait pas honneur au temps et au talent investis.

AE :Les nominations des Grammys Awards ont été annoncées. Sur les 7 artistes africains nominés, seule Angélique Kidjo est d’Afrique francophone. Pensez-vous que la partie francophone du continent a du retard sur la partie anglophone ?
FAK : On a un retard qui est factuel. Mais il faut aussi prendre en compte que la partie anglophone est tirée par une locomotive qui est le Nigeria. Démographiquement, le Nigeria est un petit continent avec 220 millions d’habitants, ce qui en fait presque une industrie musicale à part. Il faut rassembler pas mal de pays d’Afrique francophone pour avoir la population du Nigeria à lui seul, donc à un moment, il faut savoir raison garder et ne pas faire des comparatifs qui n’ont pas lieu d’être. Moi je préfère m’inspirer de la manière dont ils ont évolué parce que le Nigeria de maintenant n’est pas le Nigeria d’il y a 20 ans. Leur industrie musicale a accéléré à un moment donné et c’est important de se demander ce qui s’est passé et comment ils ont opéré ce shift. Ils ont pleinement bénéficié de la transition vers le numérique et je pense qu’il faut les applaudir et les étudier pour comprendre comment évoluer.
AE : En plus, pour en revenir aux Grammys, Angélique Kidjo est la seule nominée d’Afrique francophone, mais elle est l’artiste ayant remporté le plus de fois cette récompense en Afrique. Est-ce que c’est juste de dire alors qu’on n’a pas un problème de qualité des artistes mais plutôt de promotion de leur travail ?
FAK : Vous savez, c’est une compétition qui a des critères bien particuliers. L’académie qui décerne les Grammys a ses critères et d’ailleurs, certains applaudiront mais certains se demanderont s’il n’y a aucun renouvellement au niveau de la musique africaine. Cette année on retrouve des habitués comme Angélique Kidjo et Burna Boy. Est-ce que cela signifie qu’il n’y a rien de nouveau ou est-ce que c’est la grille de lecture de l’académie qui doit évoluer. C’est une question qui est ouverte. Quoi qu’il en soit, je ne pense pas que les artistes africains francophones doivent changer leurs modes de promotion. Ils doivent se concentrer sur la production de la musique. Angélique Kidjo est autant nominée et a remporté autant de Grammys surtout à cause de la qualité de sa musique. Les jeunes artistes d’Afrique francophone doivent en prendre de la graine et s’en inspirer parce qu’elle excelle dans ce qu’elle fait. Les artistes doivent accepter d’investir des moyens et du temps dans leur travail pour viser la qualité des albums qu’elle produit. Dans un contexte actuel avec internet où tout va très vite, les musiciens doivent accepter de prendre le temps de travailler sur leur musique. La bonne musique c’est le meilleur marketing pour un artiste.
AE : Les conseils que vous donnez aux jeunes musiciens sont très intéressants. Dans une vie précédente vous étiez le rappeur Black Kent, très connu dans l’espace francophone. Quel conseil Franck-Alcide Kakou aurait donné à Black Kent pour sa carrière ?
FAK : Je lui aurais aussi demandé de prendre un peu plus de temps et que ce n’est pas un sprint, c’est une course de fond. J’étais très productif, peut-être un peu trop. Je lui aurais demandé d’accepter que ça prenne du temps et de ne pas s’éparpiller parce que savoir faire beaucoup de choses ça peut être un atout, mais quand ce n’est pas maitrisé, ça devient un poids qu’il faut porter. Donc je lui dirais prends du temps, sois plus exigeant avec toi-même, sois plus indulgent avec toi-même et ne t’éparpille pas.
AE : Est-ce que vous ne trouvez pas que l’arbre Afrobeats cache les autres sonorités que le continent peut offrir au monde comme celles d’Afrique francophones qui peuvent être différentes de la version mainstream qu’on voit souvent à l’international ?
FAK : Je ne suis pas vraiment d’accord. Il y a un genre mainstream qui est l’Afrobeats et il a son importance parce que c’est une pluralité de sonorités. Ce genre voyage bien mais n’a pas fait que les Ivoiriens arrêtent leur Zouglou, que les Camerounais arrêtent le Makossa ou que le Sénégal arrête le Mbalax. Il s’agit surtout de viser un public et de trouver les meilleurs ponts entre lui et la musique. Il y a par exemple le rappeur sénégalais Samba Peuzzi, que nous accompagnons, qui a cette réflexion. Il cherche à trouver les moyens de toucher d’autres publics avec de la musique sénégalaise malgré la barrière de la langue parce que le Mbalax a quelque chose de particulier que les autres genres Afrobeats n’ont pas. Il travaille sur une manière de le présenter au monde pour proposer quelque chose de nouveau. Donc effectivement, des gens ont tendance à simplifier et à tout mettre dans le panier de l’Afrobeats mais croyez-moi, les Ivoiriens, les Congolais, les Camerounais, les Béninois, les Maliens sont fiers des genres musicaux de chez eux et continueront de les produire.
Agence ECOFIN





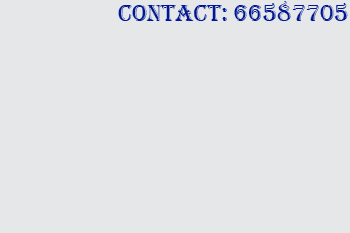






Recent Comments
Un message, un commentaire ?