
Dans le tournant historique en cours en Afrique, la France, pas plus que la Chine
ou la Russie, ne peut imposer sa loi. L’avenir des Africains est entre leurs mains.
Pour nouer des relations apaisées avec ses anciennes colonies, la France doit cesser
de penser le continent sous l’angle sécuritaire *
Aujourd’hui, le fait majeur dans les relations entre la France et ses anciennes colonies
n’est pas la permanence de la « Françafrique », sauf si, par ce mot, on désigne non un concept mais un fantasme partagé : celui de la toute puissance. D’ailleurs, le voudrait-elle, la France n’est plus en position de dicter ses choix. En vérité, l’étau qu’elle maintenait sur ses dépendances africaines s’est largement desserré. Ce relâchement n’est pas le résultat d’un astucieux calcul, encore moins d’un grand dessein. Produit de rafistolages et conséquence directe d’un grand
basculement démographique, il n’est guère accidentel. La plupart des outils
militaires, monétaires ou symboliques auxquels la France a eu recours pour
maintenir sa présence sur le continent sont soit désuets, soit délégitimés. Le
temps est peut-être venu de s’en débarrasser, et en bon ordre. Pour qui
cherche à saisir les dynamiques en cours, il s’agit de tourner le dos aux
poncifs (« sentiment anti-français ») et aux fausses notions (« Francafrique »)
et de revenir à la longue durée. La fin d’un cycle historique
L’Afrique est en effet entrée dans un nouveau cycle historique. La période
ouverte au lendemain de la Seconde Guerre mondiale fut ponctuée par la
mise en place, dans les anciennes possessions françaises d’Afrique subsaharienne, d’un régime qui s’apparentait à la décolonisation. Désormais dépourvu de ses ressorts profonds, ce
complexe paracolonial est en train de mourir d’une mort naturelle. Le
continent fait en effet l’expérience de transformations multiples et simultanées. D’ampleur variable, elles touchent tous les ordres de la société, à commencer par la démographie
– selon les projections des Nations unies, les Africains seront 2,4 milliards en 2050, dont la moitié aura moins de 25 ans. Concrètement, elles se traduisent par des ruptures en cascade. Mais aucune n’a, jusqu’à présent, débouché sur une révolution sociale de large envergure. Mue par des
forces pour l’essentiel endogènes et prise dans un mouvement brownien,
l’Afrique est en train de se retourner sur elle-même.
L’évolution du jeu géopolitique, le relatif affaiblissement de l’Europe sur
l’échiquier mondial et l’émergence de la Chine et d’autres puissances
moyennes ont contribué à ce retournement. Mais cela n’explique pas tout.
Reste que, dans le tournant historique
en cours, la France n’est plus qu’un acteur secondaire. Non parce qu’elle aurait été évincée par la Russie, la Chine, la Turquie ou les pays du Golfe, mais parce que les luttes sociales, culturelles et politiques les plus importantes portent désormais sur le contrôle des outils de prédation, le monopole de la force et l’accès aux moyens d’existence. Désormais, elles opposeront
d’abord les Africains entre eux.
Prenons-donc les choses autrement. A commencer par ce qui relève de l’économie politique proprement dite et du basculement en marche vers une autre forme de société et
d’État. En effet, le trait marquant de ce début du xxie siècle est l’entrée du continent dans une nouvelle phase de l’histoire de l’accumulation privée.
Celle-ci se caractérise par l’intensification de la prédation et de l’extractivisme (extraction de matières premières, exploitation de gisements…).
Sur le plan spatial, les zones grises se sont multipliées et une course effrénée à la privatisation des ressources du sol et du sous-sol a été engagée. Des marchés régionaux de la violence sont
apparus, dans lesquels s’investissent toutes sortes d’acteurs en quête de pouvoir et de profits, des multinationales aux services privés de sécurité militaire. Leur fonction première est
de monnayer la protection contre l’accès privilégié à des ressources rares.
Grâce à ces formes nouvelles du troc, les classes dirigeantes peuvent assurer leur mainmise sur des pans entiers de l’État, sécuriser les zones de ponction, militariser les échanges au loin
et consolider leur arrimage aux réseaux transnationaux de la finance et du profit.
Une jeunesse déboussolée Cette nouvelle phase de l’histoire de l’accumulation privée a entraîné la
brutalisation et le déclassement des couches subalternes. Exclues du salariat et de l’emploi formel, reléguées aux marges de la citoyenneté, elles constituent aujourd’hui un véritable
précariat. Les victimes principales de ce déclassement et de l’enfermement qui en est le corollaire sont les « cadets sociaux » (les sans-travail, les femmes, les minorités sexuelles ou religieuses), soumis à un régime de claustration plus insidieux qu’à l’époque coloniale.
Ce processus à l’œuvre a aussi abouti à des fractures sociales prononcées. A la génération sacrifiée de l’époque des ajustements structurels (1985-2000) est venue s’en ajouter une autre, celle
de ceux qui sont nés dans les années 1990-2000, et qui ont grandi dans un temps de crise économique et d’insécurité sans précédent, bloqués de l’intérieur par une gérontocratie rapace, et interdits de mobilité aussi bien interne qu’externe en
conséquence des politiques anti migratoires européennes et d’une gestion archaïque des frontières héritées de la colonisation. Ainsi, aux enfants-soldats des guerres de prédation d’hier
s’est superposée la foule des adolescents et mineurs qui n’hésite pas à acclamer les putschistes, lorsqu’elle ne se retrouve pas aux premiers rangs des émeutes urbaines.
Déboussolée et sans avenir, une partie de la jeunesse née dans les années 1990-2000 est animée par le désir d’une violence cathartique, voire purgative, à un moment d’extraordinaire atonie intellectuelle parmi les élites politiques et économiques. A cela s’additionnent les effets de crétinisation de masse induits par les réseaux sociaux. Dans la plupart des pays, sphère médiatique et débats publics sont colonisés par des représentants d’une génération plombée par un analphabétisme fonctionnel, conséquence des décennies de sous-investissement dans l’éducation.
A ces lames de fond se greffent des déplacements dans les champs culturel et imaginaire. Le plus significatif est la montée en puissance du « néo souverainisme ». A l’origine, celui-ci était une réponse au diktat des institutions financières internationales. Au milieu des années 1980, il revêtait la forme d’une réfutation des thèses de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international sur les conditions d’une croissance africaine, et d’appels en faveur d’un modèle endogène de développement sur le continent. Il apparaissait également sous la forme d’une critique de la démocratie libérale et de sa « faisabilité » en milieu africain.
C’est autour des années 2010, avec la défaite des mouvements citoyens de
la deuxième génération, qu’émerge une version populiste du néo souverainisme. Dans le contexte actuel de désarroi idéologique, de désorientation morale et de crise du sens, celui-ci est moins un projet politique cohérent qu’un grand fantasme. Aux yeux de ses tenants, il remplit d’abord
la fonction de ferment d’une communauté émotionnelle et imaginaire, et c’est ce qui lui octroie toute sa force.
Ses principaux bataillons se recrutent parmi les franges de la jeunesse continentale. Il puise aussi dans l’immense réservoir des diasporas. Souvent mal intégrée dans les pays où elle est née et
a grandi, et parfois traitée par ces pays qui l’ont accueillie en citoyennes et citoyens de seconde zone, une bonne partie de la jeunesse afro-descendante assimile ses épreuves aux grands combats panafricanistes de l’après-guerre contre le colonialisme.
Le néo souverainisme, notamment sous sa version populiste, n’est pourtant pas l’exact équivalent du panafricanisme. Ce que l’on n’a pas assez souligné, c’est à quel point l’anticolonialisme et le panafricanisme auront contribué à l’approfondissement de trois grands piliers de la conscience
moderne, à savoir la démocratie, les droits humains intrinsèques et l’idée d’une justice universelle. Or, le néo souverainisme se situe en rupture avec ces trois éléments fondamentaux. D’abord, se réfugiant derrière le caractère supposé primordial des races, ses tenants rejettent le concept
d’une communauté humaine universelle. Ils opèrent par identification d’un bouc émissaire qu’ils érigent en ennemi absolu contre lequel tout est permis. Les néo souverainistes estiment que c’est en boutant hors du continent les vieilles puissances coloniales, à commencer par la France,
que l’Afrique parachèvera son émancipation. Quitte à les remplacer par la Russie ou la Chine.
Ils s’opposent, d’autre part, à la démocratie, qu’ils considèrent comme un gadget, le cheval de Troie de l’ingérence internationale dans les affaires africaines. A celle-ci, ils préfèrent le culte des « hommes forts »,adeptes du virilisme et pourfendeurs de l’homosexualité. D’où l’indulgence
à l’égard des coups d’État militaires et, au besoin, de la violence, comme voies
légitimes de conquête. Cette version populiste du néo souverainisme sévit
dans un contexte marqué par un affaiblissement notable des organisations de la société civile et l’affaissement des corps intermédiaires. Effet pervers des longues années de glaciation autoritaire, le charisme individuel et la richesse matérielle sont désormais privilégiés au détriment
du lent et patient travail de construction des institutions, tandis que les visions transactionnelles et clientélistes de l’engagement politique l’emportent sur le volontariat ou le bénévolat.
Face à l’enchevêtrement de crises en apparence inextricables, la démocratie électorale n’apparaît plus comme un levier efficace des changements profonds auxquels aspirent les nouvelles générations. Truquées en permanence, les élections elles-mêmes sont devenues la cause de conflits sanglants. Les expériences récentes de multipartisme n’ont, quant à elles, guère permis de juguler la corruption. Au contraire, elles s’en sont nourries et ont légitimé la perpétuation au pouvoir d’élites anciennes, responsables des impasses actuelles.
Dans ces conditions, les coups d’État apparaissent de plus en plus comme
la seule manière d’assurer une forme d’alternance.

Repenser le partenariat
Ni l’invocation rituelle de la « Françafrique », encore moins la référence au « sentiment anti-français » ne rendent compte de ces mouvements en profondeur. Dans l’ensemble, un
autre ordre étatique africain est en gestation. Il prendra beaucoup de
temps à se cristalliser. Dépendant de l’intensité des luttes qui accompagneront leur déclin et leur démantèlement, ce nouvel ordre sera fait de fragments, voire de lambeaux d’États,
qui se juxtaposeront sur des territoires eux-mêmes relativement cloisonnés. Il inclura par ailleurs des communautés sans État ou des pans de territoires soumis à des dynamiques de dérégulation prononcée. Tous ne pourront pas se prévaloir d’être des communautés démocratiques. Dans
certains cas, les frontières héritées de la colonisation se disloqueront.
Dans l’immédiat, le danger est que l’Afrique soit transformée en lieu de confrontation entre des puissances sur le déclin et d’autres en pleine ascension, dans le contexte du conflit
global en cours de déploiement opposant les États-Unis et la Chine. Aucune puissance externe ne dispose à elle seule des capacités d’imposer sa loi sur le continent. La France, en particulier, n’a plus les moyens de ses ambitions en Afrique. En tant que modèle de vassalisation et de prédation,
la « Françafrique » reposait sur le maillage du continent par des bases militaires, ainsi qu’une présence active dans un certain nombre de pays transformés en têtes de pont de l’influence
française sur le continent. S’y ajoutait un ordre monétaire articulé sur les francs CFA en Afrique de l’Ouest, en Afrique centrale et dans certaines îles de l’océan Indien. Pendant très longtemps, la France a récolté les dividendes de cet ordre monétaire. Le franc CFA à lui tout seul ne garantit
plus, de nos jours, la pérennisation de « marchés captifs ».
L’autre pilier était culturel. La langue française et ses institutions servaient de ciment et de relais crucial dans la redistribution des capitaux symboliques aux élites politiques, administratives et intellectuelles africaines. Tel n’est plus le cas. Couplées avec l’utilisation des technologies digitales, les langues vernaculaires se prêtent à toutes formes d’hybridation et regagnent du terrain, souvent
au détriment du français formel. Que dire de l’instrumentalisation des visas – y compris pour les entrepreneurs, les étudiants, les intellectuels, les artistes ou les chercheurs –, afin de contrôler la mobilité ? La prime à la circulation, l’une des pierres angulaires du commerce des élites françaises et africaines sous le régime de la « Françafrique », a été ensevelie sous les décombres de la politique anti migratoire. Tous ces facteurs ont contribué à accentuer l’effet repoussoir. Ne restent plus que les chiffons rouges, oripeaux d’une époque révolue que sont les bases militaires, le franc CFA, les Instituts français, les magasins Auchan et, bientôt peut-être, l’Agence française de développement.
Le président Emmanuel Macron aura tenté, a maintes reprises, de crever l’abcès. Résultat, la France a mené, à partir de 2017, une politique africaine à deux faces. L’une,
nocturne, est fondée sur la psychose militaro-sécuritaire portée par une vision régressive de la paix, de la stabilité et de la sécurité sur le continent. Assumée jusque dans ses ultimes
conséquences au Sahel et mise en pratique dans les relations avec les vieux
potentats de l’Afrique centrale, elle a débouché sur une vertigineuse dégradation de l’image de la France en Afrique. L’autre face, plus ou moins solaire, s’est donnée à voir dans des
chantiers tels que la restitution des objets d’art, le travail sur les mémoires coloniales, l’organisation de la Saison Africa2020, la mise en place de la
Fondation de l’innovation pour la démocratie et de la Maison des mondes
africains, que j’ai proposée en 2021, ou l’intérêt porté aux industries culturelles et créatives. Adossée à la vision d’une Afrique à fuseaux multiples, mobile et ouverte sur le siècle, elle aurait pu accompagner une mutation du paradigme africain dans l’imaginaire français. Entre ces deux visages, une relation profondément mercantile est en train d’être tissée avec les États anglophones et lusophones, à l’exemple de l’Afrique du Sud, du Nigeria ou du Mozambique.
Mais si bien des chantiers ont été ouverts, force est de reconnaître qu’il a été difficile de les inscrire dans un narratif puissant, ou de répondre aux attentes des nouvelles générations dans
leur quête d’autonomie, de sens et de souveraineté. En l’absence d’une cohérence intellectuelle solide, ces différents visages de la politique africaine de la France ont souvent été à l’origine de contradictions, au point de la rendre parfois illisible. Il en a résulté une dépréciation de la parole
institutionnelle. Au plus haut niveau de l’État français, l’emprise des militaires et des milieux du renseignement sur la politique africaine reste démesurée. Sur le long terme, une politique africaine libérale est incompatible avec une politique intérieure régie par une forte demande autoritaire et sécuritaire, voire xénophobe.
Continuer de penser le continent uniquement sous l’angle sécuritaire, en termes de parts de marché à conquérir ou de zones d’influence, est un projet à courte vue. C’est à un complet réaménagement mental qu’il faut procéder pour trouver la juste distance – ni ingérence ni indifférence –, qui permettrait d’autres modes de présence, voire la construction d’un partenariat qui n’impose rien.
POUR EN SAVOIR PLUS
La Françafrique
P. Barthélémy, S. Panata, « Militantes
africaines et organisations féminines
internationales dans la guerre froide. Un
pragmatisme stratégique », Clio n° 57,
2023.
J.-P. Bat, Le Syndrome Foccart. La
politique française en Afrique, de 1959 à
nos jours, Gallimard, 2012 ; La Fabrique
des « barbouzes ». Histoire des réseaux
Foccart en Afrique, Nouveau Monde,
2015, rééd., 2017 ; Les Réseaux Foccart.
L’homme des affaires secrètes, Nouveau
Monde, 2018, rééd., 2020.
T. Borrel, A. Boukari-Yabara,
B. Collombat, T. Deltombe (dir.), Une
histoire de la Françafrique. L’empire qui ne
veut pas mourir, Seuil, 2021, rééd., 2023.
T. Chafer, La Fin de l’empire colonial
français en Afrique de l’Ouest, Rennes,
Presses universitaires de Rennes, 2019.
T. Deltombe, M. Domergue, J. Tatsitsa,
La Guerre du Cameroun. L’invention de
la Françafrique, La Découverte, 2016.
S. Diarra, Les Faux Complots d’HouphouëtBoigny, Karthala, 1997.
F. Grah Mel, Félix Houphouët-Boigny.
L’épreuve du pouvoir, Karthala, 2010.
A. Mbembe, Sortir de la grande
nuit. Essai sur l’Afrique décolonisée,
La Découverte, 2013.
F. Pigeaud, N. Samba Sylla,
De la démocratie en Françafrique.
Une histoire de l’impérialisme électoral,
La Découverte, 2024.
Le Rwanda
S. Audoin-Rouzeau, A. Becker,
S. Kuhn, J.-P. Schreiber (dir.), Le Choc.
Rwanda 1994. Le génocide des Tutsi,
Gallimard, 2024.
R. Doridant, F. Graner, L’État français
et le génocide des Tutsis au Rwanda,
Marseille, Agone, 2020.
V. Duclert (dir.), Le Génocide des Tutsi
au Rwanda. Devoir de recherche et droit
à la vérité, Seuil, 2023.
H. Dumas, Sans ciel ni terre. Paroles
orphelines du génocide des Tutsi,
La Découverte, 2020, rééd., 2024 ;
Le Génocide au village, Seuil, 2014,
rééd. Points, 2024.
L. Larcher, Papa, qu’est-ce qu’on a fait
au Rwanda ? La France face au génocide,
Seuil, 2024.
F. Piton, Le Génocide des Tutsi du
Rwanda, La Découverte, 2018.
F. Robinet, « Le rôle de la France au
Rwanda : les journalistes français au
cœur d’une nouvelle guerre de mémoire,
1994-2015 », Le Temps des médias n° 26,
2016/1 ; Silences et récits. Les médias
français à l’épreuve des conflits africains,
1994-2015, Bry-sur-Marne, INA, 2016.
* Tribune publié dans la revue l’Histoire, Numéro 518 d’avril 2024
Par Achille Mbembe





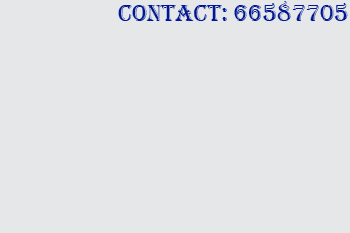






Recent Comments
Un message, un commentaire ?